Découvertes pour la vie
Les visages de la recherche en santé 2023
| Titre |
|---|
Un essai contrôlé randomisé multicentrique axé sur le transfert de bactéries intestinales saines pourrait aider les patients à contourner la résistance aux antimicrobiens
L’infection à Clostridioides difficile (ou C. difficile), qui touche le gros intestin, peut survenir à répétition puisqu’elle est souvent traitée par des antibiotiques qui perturbent les bactéries intestinales saines et provoquent l’apparition de gènes résistants aux antibiotiques et de bactéries multirésistantes aux médicaments (parfois appelées superbactéries). Pire encore, une infection invasive à une superbactérie peut entraîner de graves conséquences, voire la mort. La transplantation de microbiote fécal s’est avérée un traitement sûr et efficace contre les infections récurrentes à C. difficile, car les bactéries intestinales transplantées au patient proviennent d’un donneur en bonne santé. Dans le cadre d’une étude multicentrique menée dans six pays, la Dre Kao et son équipe à l’Université de l’Alberta comparent la transplantation de microbiote fécal lyophilisé sous forme de comprimés aux antibiotiques normalement prescrits aux patients atteints de leur première infection à C. difficile. Cette étude pourrait contribuer à diminuer le risque de récurrence de l’infection à C. difficile ainsi que l’apparition de superbactéries, en plus de rétablir le microbiote des patients. L’équipe de la Dre Kao prélèvera également des échantillons aux fins d’étude à l’échelle moléculaire. Si les résultats s’avèrent concluants, la transplantation de microbiote fécal pourrait représenter une option thérapeutique prometteuse pour remplacer les antibiotiques et combattre les superbactéries. Lectures complémentaires |
À la conquête des causes du cancer liées au milieu de vie et au travail
Notre santé subit les effets parfois bénéfiques, parfois néfastes des expositions à divers éléments dans notre environnement de nature structurelle, physique ou chimique. Or, étant donné l’insuffisance des données actuelles sur la cancérogénicité potentielle de ces éléments, il est difficile de prévenir le cancer au sein de la population. C’est pourquoi la Dre Marie-Élise Parent, de l’Institut national de la recherche scientifique, emploie des méthodes épidémiologiques pour déterminer comment les expositions dans le milieu de vie et au travail peuvent augmenter le risque de cancer. Elle étudie en particulier les causes environnementales du cancer de la prostate. Si l’exposition à certains pesticides est associée à l’apparition de ce cancer, on demeure dans le noir pour ce qui est des autres agents environnementaux. Les recherches de la Dre Parent ont établi des liens entre le cancer de la prostate d’une part et une exposition à des produits chimiques (métaux, solvants, polluants atmosphériques) et le stress au travail d’autre part. La Dre Parent a en outre récemment élargi son horizon de recherche dans le but de montrer comment l’environnement social peut miner les chances des hommes veufs chez qui on a diagnostiqué un cancer de la prostate. Elle a ainsi mis en évidence une population vulnérable qui pourrait bénéficier d’une surveillance clinique accrue. Ses recherches ont également révélé le rôle que peuvent jouer les cellulaires dans l’apparition de tumeurs cérébrales. Lectures complémentaires
|

Équité en santé : Des services médicaux inclusifs et bienveillants pour les jeunes transgenresFace aux idées reçues et aux discriminations, l’accès à des soins de santé sûrs, inclusifs et propices à l’affirmation de genre en Ontario demeure encore aujourd’hui précaire, en témoignent les taux élevés et inquiétants de dépression, d’anxiété, d’estime de soi, d’usage problématique de psychotropes, d’automutilation et de suicides observés chez la population transgenre de la province. Quels obstacles affrontent les jeunes transgenres dans l’accès aux soins de santé? Comment en venir à bout? Le Dr Alex Abramovich, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en itinérance et santé mentale chez les jeunes 2ELGBTQIA+ à l’Institut de recherche en politiques de santé mentale et au Centre de toxicomanie et de santé mentale, aspire à apporter des réponses à ces questions dans le cadre d’un projet axé sur les liens qui unissent la santé mentale et physique. Accompagné de son équipe de recherche, il analyse des données administratives recueillies par la communauté et des hôpitaux et mène des entretiens individuels approfondis qui l’aideront à mettre en évidence des points essentiels de l’expérience et des besoins d’environ 3000 jeunes transgenres en matière de santé. Chercheur transgenre affirmé, le Dr Abramovich joue un rôle de protagoniste au sein de sa communauté et milite pour l’inclusion et pour la création d’espaces sûrs depuis plus de 15 ans. Grâce à sa compréhension intime de nombreux aspects de l’expérience transgenre, il pourra mettre ses points de vue et son expérience uniques au service du projet. Il espère en tirer des conclusions salutaires qui contribueront à éclairer les processus décisionnels cliniques, à sensibiliser les familles, à perfectionner les programmes de formation offerts au corps médical et à promouvoir des politiques propices à l’inclusion et à l’affirmation de genre. L’ambition ultime du Dr Abramovich est de formuler des recommandations qui encadreront la mise en place de services médicaux sûrs, bienveillants, inclusifs et adaptés aux besoins des jeunes transgenres qui atteignent l’âge adulte. Ses conseils clairvoyants ouvriront la voie à l’adoption d’approches de soins ciblées dans la perspective de renforcer l’efficacité des services actuels et d’aider les jeunes transgenres à s’affirmer et à mener une vie épanouissante en bonne santé. La démarche du Dr Abramovich est fondée par son engagement profond à veiller à ce que ces jeunes bénéficient du soutien et des ressources nécessaires pour aborder la vie adulte dans les meilleures conditions.
Institut |
Un réseau de dépistage national pour freiner le diabète de type 1
Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie chronique qui touche 300 000 personnes au Canada. Pas moins de 33 000 enfants canadiens (de 5 à 18 ans) en sont atteints et la prévalence est en hausse. On sait que le DT1 commence à se développer bien avant l’apparition des symptômes, mais le diagnostic chez l’enfant est rarement posé avant le constat d’une hyperglycémie. Mentionnons que les enfants aux prises avec le DT1 ne sont pas à l’abri de complications potentiellement mortelles, comme l’acidocétose diabétique. La Dre Wherrett, de l’Hôpital pour enfants de Toronto (SickKids) et de l’Université de Toronto, dirige un consortium de recherche dans la conception d’un réseau de dépistage national, nommé CanScreenT1D, qui facilitera la détection du risque accru de DT1 chez l’enfant. Avec la collaboration d’enfants, de diabétologues, de généticiens, de spécialistes du dépistage néonatal, de chercheurs, de décideurs, de personnes diabétiques et de groupes consultatifs d’ici et d’ailleurs, cette équipe mettra d’abord en place une infrastructure clinique et de laboratoires, puis elle procédera à une évaluation globale dans l’optique de permettre le diagnostic plus précoce de la maladie, et ainsi éviter les cas d’acidocétose diabétique. Combinés à d’autres initiatives de recherche en cours, les travaux de l’équipe amélioreront aussi l’accès aux thérapies pouvant prévenir ou freiner le DT1. Lectures complémentaires |
Améliorer le diagnostic et le traitement du cancer de l’ovaire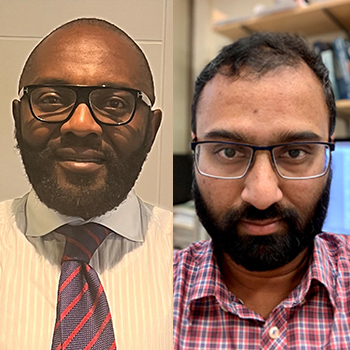
L’examen diagnostique pour la plupart des cancers est axé sur les biopsies ou les biomarqueurs sériques, ainsi que l’utilisation de techniques d’imagerie comme la tomographie par émission de positrons (TEP), l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou la tomodensitométrie. Cependant, ces méthodes ne sont pas assez précises pour le diagnostic de plusieurs types de cancers. Les biopsies s’appuient sur des échantillons de tumeur, mais elles ne permettent pas aux médecins de connaître l’étendue de la maladie. Pour leur part, les IRM et la tomodensitométrie ne fournissent que des informations anatomiques. En ce qui a trait au cancer de l’ovaire, le CA125 est un biomarqueur abondant à la surface des cellules cancéreuses qui permet la détection de la maladie; toutefois, sa précision à un stade précoce est de moins de 60 %. Les Drs Fonge et Uppalapati de l’Université de la Saskatchewan mettront au point une sonde qui pourra être utilisée spécifiquement de pair avec la TEP afin d’améliorer la détection de protéines MUC16 sur les cellules du cancer de l’ovaire. Ils se serviront d’un anticorps capable de déceler une abondance de MUC16 et élimineront les cellules cancéreuses à l’aide de puissants rayonnements ionisants. Cette radiothérapie – connue sous le nom de « alphathérapie » – pourrait aussi être utilisée pour stimuler différentes cellules immunitaires à l’intérieur du microenvironnement tumoral. Les Drs Fonge et Uppalapati étudieront aussi la façon dont les anticorps radiomarqués peuvent être utilisés pour stimuler les cellules immunitaires et être combinés à d’autres inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Lectures complémentaires |
Étudier les lymphocytes MAIT pour mieux traiter le sepsis
Selon de récentes estimations, 1 décès sur 18 au Canada est lié au sepsis, et le coût du traitement des patients atteints s’élève à environ 325 millions de dollars par année. Causé par une réaction inflammatoire disproportionnée face à une infection, le sepsis est un problème de santé complexe comportant plusieurs phases. Bien qu’une amélioration des soins intensifs et des mesures de réanimation aient réduit la mortalité en début de sepsis, bon nombre de survivants présentent des complications à long terme, notamment des déficits immunitaires. En l’absence d’un remède, le Dr Haeryfar de l’Université Western cherche à comprendre comment se produisent les réactions inflammatoires en début de sepsis et comment une diminution progressive du nombre et des activités des cellules MAIT (mucosa-associated invariant T ou lymphocytes T non conventionnels associés aux muqueuses) contribuerait à une immunosuppression induite par le sepsis au fil du temps. En se servant de modèles murins pertinents sur le plan clinique et d’échantillons de sang de patients gravement malades pour étudier la réaction des lymphocytes MAIT aux infections, l’équipe de recherche du Dr Haeryfar espère mettre au point de nouvelles interventions qui atténueront les réactions inflammatoires en début de sepsis et mettront fin à l’immunosuppression dans la phase prolongée de cette terrible maladie, afin d’épargner des vies et d’économiser l’argent des contribuables. Lectures complémentaires |

Les différences entre les sexes dans l’insuffisance cardiaque droiteLe ventricule droit du cœur et le rôle de la progestérone dans l’insuffisance cardiaque comportent des inconnues majeures Sur les bancs d’école, vous avez sans doute appris que le cœur est formé de quatre cavités : les oreillettes droite et gauche, et les ventricules droit et gauche. Il est bon de le savoir, étant donné que les maladies cardiaques ne touchent souvent qu’un seul côté du cœur. Et, question de compliquer un peu plus les choses, il pourrait y avoir des différences selon le sexe biologique dans la façon dont l’insuffisance cardiaque se développe. Le Dr Ketul Chaudhary, qui travaille au Département de physiologie de l’Université Dalhousie, étudie actuellement les différences entre les sexes dans l’insuffisance ventriculaire droite afin d’élucider les effets de la progestérone, une hormone sexuelle féminine, sur le fonctionnement du ventricule droit et le rôle qu’elle joue dans l’insuffisance cardiaque. Selon le Dr Chaudhary, on en sait peu au sujet de l’incidence du sexe biologique sur le fonctionnement du ventricule droit d’un cœur sain et d’un cœur malade. En fait, on en sait généralement moins sur le côté droit du cœur que sur le côté gauche. Dans un contexte où les taux d’insuffisance cardiaque augmentent et pèsent lourd sur le système de santé canadien, la mise au point d’un nouveau traitement visant spécifiquement l’insuffisance cardiaque droite permettrait d’améliorer la vie de dizaines de milliers de Canadiens et Canadiennes chaque année. Forts de nouvelles connaissances, le Dr Chaudhary et son équipe sont à la recherche de nouveaux traitements qui tiennent compte des différences hormonales. Ces connaissances sont également indispensables à la prise en charge des patients dont la production d’hormones sexuelles est altérée, comme les personnes ménopausées et celles atteintes du syndrome des ovaires polykystiques. Lectures complémentaires |
Les soins de santé à la jonction de la diversité de genre et de la consommation d’alcoolUne équipe de recherche contribuera à définir les risques liés à l’alcool et à élaborer des solutions ancrées dans la communauté 
La consommation d’alcool et de substances psychoactives est l’une des principales causes de maladie et de mortalité au Canada. Nos connaissances sont lacunaires à maints égards, sans compter le manque de soutien aux personnes transgenres et de diverses identités de genre aux prises avec une consommation problématique d’alcool. Puisque les minorités de genre doivent composer au quotidien avec des facteurs de stress, comme la discrimination et le harcèlement, elles se tournent souvent vers l’alcool en guise de réconfort. La Dre Dermody (elle), de l’Université métropolitaine de Toronto, a conçu une étude axée sur l’incidence de ces facteurs de stress sur les personnes de diverses identités de genre au Canada. Ses travaux visent à déterminer les motifs de la consommation d’alcool, puis à trouver des solutions pour réduire le risque de méfait subséquent (y compris les changements structurels pouvant éliminer les facteurs de stress chez les minorités de genre ainsi que l’intégration de mécanismes de soutien social et communautaire). La Dre Dermody est résolue à respecter et à reconnaître les personnes de diverses identités de genre au pays afin que les partenariats entre la communauté et les professionnels de la santé puissent améliorer les traitements et, ainsi, prévenir les méfaits de la consommation d’alcool. Lecture complémentaire |
Concevoir des soins de santé adaptés aux personnes transfémininesDe nouvelles recherches contribueront à l’établissement de normes de soins pour les femmes cisgenres et les personnes transféminines 
Si vous connaissez les termes « microbiome » ou « microenvironnement », vous savez sans doute qu’un biome intestinal sain favorise la santé globale. Or, de nombreuses parties de notre corps comportent leur propre microenvironnement, notamment le pénis et le vagin, dont les communautés bactériennes bénéfiques ou néfastes pour la santé diffèrent l’une de l’autre. Dans le cadre de ses travaux à l’Université Western, la Dre Jessica Prodger cherche à démontrer l’unicité du microenvironnement du vagin des personnes transgenres et les raisons pour lesquelles il nécessite d’autres modèles de soins. Nombre de personnes transféminines au Canada subissent une vaginoplastie, une chirurgie d’affirmation de genre visant à construire une vulve et un vagin à partir de tissus péniens (souvent appelée dans le milieu médical un néovagin). Les résultats de cette intervention chirurgicale sont excellents, mais il manque cruellement de lignes directrices factuelles sur les soins à long terme du néovagin. C’est pourquoi la Dre Prodger souhaite élaborer de telles lignes directrices et, ainsi, approfondir nos connaissances sur le microenvironnement du néovagin, y compris la microstructure des tissus, les bactéries et champignons et l’immunologie locale. La Dre Prodger estime que la mobilisation et l’intérêt de la communauté à l’égard de ce projet sont une indication nette de son importance. Lecture complémentaire |

Briser les stéréotypes : de nouvelles mesures de l’équité des genres et de l’état des relations intimes conçues par des jeunes de diverses identités de genreUne nouvelle étude menée par la Dre Kalysha Closson vise à établir des pratiques exemplaires pour la mesure de l’équité des genres et de l’état des relations Quand on pense à la recherche en santé, les mots relations et intimité ne s’imposent pas d’emblée. Pourtant, les proches jouent pour beaucoup dans le bien-être d’une personne. Dans cette optique, les relations des jeunes – complexes, enrichissantes, réconfortantes, parfois chaotiques – offrent un cadre particulièrement intéressant pour examiner et critiquer l’équité des genres et la santé des relations, et idéalement pour recommander de nouveaux moyens de les mesurer. La Dre Kalysha Closson, titulaire d’une bourse postdoctorale Banting au Center on Gender Equity and Health de l’Université de la Californie à San Diego, s’appuie sur sa brillante carrière en recherche sur le genre et la santé sexuelle pour mener le projet RE-IMAGYN, une étude sur la mesure de l’équité relationnelle et intersectionnelle chez les jeunes de diverses identités de genre. Menée principalement en Colombie-Britannique, cette étude mise sur la collaboration avec les jeunes femmes et les jeunes non binaires pour améliorer le suivi de l’équité des genres. À l’aide de ces jeunes femmes et jeunes queers, non binaires et non monogames, la Dre Closson instaure de nouvelles pratiques exemplaires pour mesurer l’équité des genres et l’état des relations intimes avec la participation des personnes qui sont directement concernées. Dans le cadre de l’étude, la Dre Closson forme également de jeunes associés de recherche qui travaillent à ses côtés et collabore régulièrement avec un comité consultatif de jeunes. La participation de la communauté a été des plus gratifiantes. Lorsqu’il est question des relations sexuelles des jeunes, et surtout de celles des jeunes queers, l’accent est souvent mis sur les facteurs de risque associés aux infections sexuellement transmissibles. L’intimité et le soutien que ces jeunes tirent de leurs relations passent souvent sous le radar des chercheurs et chercheuses. C’est pourquoi il est si important de reconnaître les forces des relations des jeunes queers. L’étude de la Dre Closson met de l’avant de nouveaux récits qui touchent des populations diversifiées et qui dépeignent des expériences authentiques auxquelles les jeunes pourront se référer pour établir et maintenir des relations intimes saines. Lectures complémentaires
|
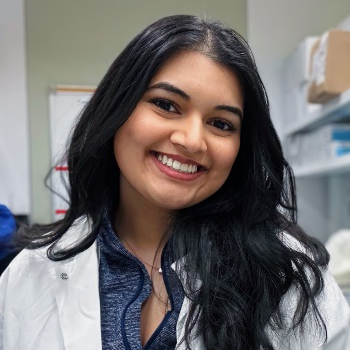
Pour mieux comprendre le lien entre le traitement du cancer et le risque de diabèteExamen de l’incidence du cisplatine sur l’apparition du diabète de type 2 Lahari Basu, Université Carleton, étudiante au doctorat La prévalence mondiale du diabète de type 2 augmente à un rythme alarmant : plus de 480 millions d’adultes vivent avec cette maladie aujourd’hui. Des recherches ont par ailleurs montré que les survivants du cancer sont plus susceptibles de se voir atteints du diabète de type 2 après leur traitement anticancéreux, ce qui fait augmenter leur risque de mortalité. Toutefois, le lien entre la survie au cancer et l’apparition du diabète reste flou. Le cisplatine est un agent chimiothérapeutique couramment utilisé pour traiter une grande variété de cancers. Or, le Bruin Lab a montré que l’exposition au cisplatine compromet la fonction des cellules bêta, une caractéristique clé de l’apparition du diabète de type 2. L’objectif principal de mon doctorat est donc de comprendre comment le cisplatine altère les cellules bêta. Dans le cadre de mes recherches, j’exposerai des souris au cisplatine et étudierai ensuite la façon dont ce dernier perturbe la sécrétion d’insuline, puis affecte la fonction et la santé des cellules bêta. Il s’agira d’une première étape essentielle pour concevoir des interventions ciblées qui amélioreront la santé métabolique à long terme des survivants du cancer et qui pourraient réduire leur susceptibilité au diabète de type 2. Lectures complémentaires |

La transplantation d’un microbiome fécal peut elle freiner la progression du diabète de type 1?Rana Minab, étudiante au doctorat, Université de la Colombie Britannique Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie auto immune où le système immunitaire s’attaque aux cellules productrices d’insuline du pancréas, puis mine la capacité du corps à produire de l’insuline. Les causes des attaques immunitaires demeurent inconnues, mais nous savons que le DT1 est lié à des facteurs environnementaux, notamment les antibiotiques, les virus et la nutrition. Ces facteurs peuvent perturber les bactéries intestinales (appelées le microbiome) et déclencher des réponses auto-immunes pouvant évoluer en DT1. Récemment, un essai clinique réalisé aux Pays Bas a montré que la transplantation de selles de participants volontaires chez des personnes atteintes de DT1 a influé sur la progression de la maladie. Pour déterminer si des modifications au microbiome peuvent ralentir la progression du DT1 et mener à d’éventuels traitements, nous effectuerons des transplantations de microbiome fécal humain dans un modèle murin de DT1 afin de comprendre les mécanismes par lesquels l’évolution des bactéries intestinales peut influer sur l’auto-immunité. Lectures complémentaires (en anglais seulement)
|

Expériences des personnes noires qui donnent naissance au CanadaRegard sur les services périnataux du point de vue des communautés noires Tamar Austin, étudiante au doctorat, Université de la Colombie-Britannique Alors que le Canada commence à cerner les inégalités fondées sur la race qui existent dans les milieux de l'éducation, de l'incarcération et de la santé mentale, les résultats et les expériences des personnes et des femmes noires qui donnent naissance au Canada sont sous-étudiés. Des recherches menées aux États-Unis et au Royaume-Uni ont établi que les personnes et les femmes noires qui accouchent courent un risque accru de mortalité et de morbidité maternelles et néonatales. Il existe cependant peu de recherches au Canada traçant un portrait détaillé de la situation en santé périnatale des personnes noires au pays, en particulier de leurs expériences liées aux soins reçus pendant la grossesse et l'accouchement. Étudiante au doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique, Mme Austin se penche sur les facteurs d'iniquité et de mauvais traitements actuels pendant la grossesse et l'accouchement, et tente de trouver des solutions inspirées de la communauté. Utilisant l'ensemble de données de l'étude Research Exploring the Stories of Pregnancy and Childbearing in Canada Today [étude des expériences actuelles de grossesse et d'accouchement au Canada], qui contient des données sur diverses populations du pays, Mme Austin entend rompre avec la tradition du milieu canadien de la recherche qui consiste à éviter la désagrégation des identificateurs de race et d'origine ethnique. Ses méthodes d'analyse intersectionnelle permettront de jeter un regard critique sur la mortalité et la morbidité maternelles et néonatales ainsi que les expériences d'accouchement vécues par les personnes noires au Canada. Lecture complémentaire |

Comment le personnel de la sécurité publique esquive les traitements du TSPTRobyn E. Shields, étudiante au doctorat, Université de Regina Le personnel de la sécurité publique (PSP) du Canada est presque dix fois plus exposé au trouble de stress post-traumatique (TSPT) que le reste de la population (23,2 % contre 2,4 %). Selon la version révisée de la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5-TR), les éléments qui rappellent un événement psychologiquement traumatique figurent parmi les critères de diagnostic d’un TSPT. En raison des spécificités de leur travail (déclenchement de sirènes, scènes d’accident), il est difficile pour les membres du PSP d’éviter complètement ces rappels. Robyn E. Shields, de l’Université de Regina, a pourtant démontré que les critères diagnostiques du TSPT énoncés dans le DSM-5 aboutissent à sa sous-estimation systématique chez le PSP. Dans son étude, elle a en effet déterminé que 2 % des sujets de l’échantillon observé parvenaient à échapper aux critères de diagnostic de TSPT du fait de leur consommation de substances psychoactives ou de leur état dissociatif. Elle recueille actuellement des données qualitatives sur ces stratégies d’évitement dans la perspective de mettre au point un outil de diagnostic précis qui permettra au PSP dans cette situation de bénéficier de soins adaptés. Lectures complémentaires (en anglais seulement)
|

Les reins qui ont des variantes génétiques peuvent-ils se réparer après une lésion?Étude du rôle des variants pathogènes du gène PAX2 dans les unités filtrantes anormalement affectées dans un modèle de tissu rénal cicatrisé de souris Joanna Cunanan, Candidate au doctorat, Institut de recherche de l’Hôpital général de Toronto, Réseau universitaire de santé; Institut des sciences médicales, Université de Toronto La glomérulosclérose segmentaire et focale (FSGS) est une maladie rénale chronique grave qui endommage les cellules filtrant le sang des reins et qui entraîne souvent une insuffisance rénale. Le développement des traitements de la FSGS stagne depuis des années et il est largement reconnu que le rein a une capacité de régénération très limitée. Nous avons déjà découvert que les variantes pathogènes du gène PAX2 représentent 4 % des cas de FSGS chez les adultes. Mes recherches portent sur le rôle que joue le gène PAX2 dans la régénération normale des reins et sur la façon dont les variantes du gène PAX2 mènent à la FSGS. Les résultats de mes recherches montrent que les souris ayant des variantes du gène PAX2 présentent des cas de FSGS plus graves que les souris normales, notamment de plus grands dommages aux tissus rénaux et une altération grave de la fonction rénale. Je propose que les cellules rénales exprimant des variantes du gène PAX2 soient compromises dans leur capacité de régénération cellulaire après une lésion de FSGS. Pour vérifier cette hypothèse, j'exécute des techniques qui peuvent identifier des milliers de gènes et de protéines au niveau de la cellule unique afin d'examiner de manière exhaustive le profil moléculaire des cellules rénales exprimant le gène PAX2 chez les souris normales ainsi que les souris ayant des variantes du gène PAX2 et comparer leur fonction et leur capacité à régénérer les cellules rénales endommagées par la FSGS. J'effectuerai également des expériences où les cellules exprimant le gène PAX2 seront suivies à l'aide de marqueurs génétiques et fluorescents pour observer comment elles changent tout au long d'une lésion de FSGS et pour déterminer si elles peuvent régénérer les cellules rénales endommagées. En résumé, mes recherches explorent le rôle du gène PAX2 dans les mécanismes de réparation des reins, avec l'objectif plus général d'utiliser mes résultats pour mettre au point de nouveaux traitements pour la FSGS. Lectures complémentaires |
Réorienter les soins du diabète dans les communautés des Premières Nations du nord-ouest de l'Ontario grâce à l'autonomisation et à la prise en charge aux fins de la santé et du bien-être
Les taux de diabète sont en augmentation au Canada, constat particulièrement inquiétant pour les communautés autochtones. En grande partie à cause des traumatismes intergénérationnels liés à la colonisation, les peuples autochtones sont effectivement touchés de manière disproportionnée par le diabète de type 2. À la recherche d'une solution, la Dre Sumeet Sodhi et son équipe souhaitent découvrir si un modèle de soins particulier pour la prestation des services de prévention et de traitement du diabète conduit à de meilleurs résultats dans les communautés des Premières Nations du nord-ouest de l'Ontario. Sumeet Sodhi est professeure agrégée à la Faculté de médecine de l'Université de Toronto, où elle est également la responsable universitaire du programme de partenariat pour la santé autochtone au Département de médecine familiale et communautaire. Elle est médecin membre du personnel de l'équipe de santé familiale de l'hôpital Toronto Western et clinicienne-chercheuse au sein du Réseau universitaire de santé. Ses travaux de recherche visent à amplifier la voix des communautés vulnérables du monde entier afin d'améliorer les soins de santé primaires, en mettant l'accent sur l'équité en santé et la justice sociale dans le cadre des priorités établies par les communautés, comme l'amélioration des résultats cliniques du diabète dans les communautés des Premières Nations du nord-ouest de l'Ontario, la gestion de l'incidence de la tuberculose au Nunavut et l'étude de l'intégration de la santé publique et des soins primaires dans les pays à revenu élevé, intermédiaire et faible. Lectures complémentaires
|
Privilégier le savoir autochtone pour guider la prévention du diabète de type 2 chez les enfants au sein des communautés des Premières Nations et des Métis de la Saskatchewan
Les communautés autochtones étant touchées de façon disproportionnée par le diabète, il est essentiel de tenir compte des perspectives autochtones dans la recherche afin de s'attaquer à la source du problème, de décoloniser les approches de la recherche et de veiller à ce que les interventions soient pertinentes et viables à long terme. La professeure Sarah Oosman est la candidate principale d'une équipe de recherche qui vise à promouvoir la santé des jeunes des Premières Nations et des Métis ainsi qu'à prévenir le diabète de type 2 chez les enfants grâce à la création, à la mise en œuvre et à l'évaluation d'une trousse à outils fondée sur les modèles de résilience et de bien-être des Premières Nations et des Métis. Sarah Oosman est physiothérapeute, professeure agrégée à l'Université de la Saskatchewan et chercheuse au sein de l'Unité de recherche en santé des populations et en évaluation de la Saskatchewan (SPHERU). Canadienne de première génération d'origine ethnique mixte et alliée des colons, elle s'est engagée à mener des recherches axées sur les communautés autochtones qui conduisent à l'élaboration et à la mise en œuvre d'interventions de promotion de la santé pertinentes, utiles et adaptées sur le plan culturel qui s'adressent à des personnes de tous les âges. La mise à profit de son savoir expérientiel pour enseigner aux étudiants en physiothérapie et en médecine lui tient à cœur. Sarah travaille en étroite collaboration avec les communautés et les peuples des Premières Nations et des Métis. Elle voue une véritable passion à la lutte contre les inégalités en santé et préconise pour ce faire des relations respectueuses, des partenariats et des discussions franches offrant un espace sûr en classe, en clinique, au sein de la communauté ou dans le milieu de la recherche. |
Échanges intercommunautaires pour la prévention du diabète de type 2
Le diabète est l'une des maladies chroniques les plus courantes au Canada, et les communautés autochtones sont touchées de manière disproportionnée par le diabète de type 2. En effet, les Autochtones sont diagnostiqués plus jeunes, présentent des symptômes plus graves au moment du diagnostic et ont de moins bons pronostics que le reste de la population. Pour s'attaquer à ce problème de taille, la Dre Lucie Lévesque, professeure à l'Université Queen's, dirige une équipe multidisciplinaire de chercheurs autochtones et alliés s'intéressant à la prévention du diabète. L'équipe fait partie intégrante d'un programme primé de prévention du diabète dans les écoles de Kahnawake (en anglais seulement) qui promeut une alimentation saine, l'activité physique et le mieux-être holistique dans les communautés autochtones. En utilisant une approche communautaire basée sur une perspective haudenosaunee du traité Two Row Wampum, et en tenant compte de la diversité des genres, l'équipe de la Dre Lévesque étudiera un modèle de mentorat intercommunautaire pour favoriser la prévention du diabète de type 2. Ces travaux de recherche seront les premiers à porter sur la façon dont la résilience communautaire peut être mise à profit pour prévenir ce type de diabète au sein des communautés autochtones. Les résultats permettront d'établir des approches durables de prévention du diabète de type 2, susceptibles d'être adoptées dans d'autres communautés à travers le Canada, en vue de promouvoir le bien-être des peuples autochtones. Les cocandidats principaux du projet sont les utilisateurs des connaissances et chercheurs kanienkehaka suivants : Alex M. McComber, Kahnawake, Treena Wasonti:io Delormier, Kahnawake, Université McGill, et Brittany Wenniserí:iostha Jock, Akwesasne, Université McGill; et le chercheur allié Dave Bergeron, Université du Québec à Rimouski. Lectures complémentaires |
Combler l’écart dans les soins des maladies cardiovasculaires chez les femmesPrestation en ligne d’un outil de réadaptation cardiovasculaire pour aider les femmes à améliorer leur qualité de vie 
Les maladies cardiovasculaires représentent la principale cause de morbidité et de mortalité chez les femmes partout dans le monde. Malgré tout, ces maladies demeurent sous-estimées, sous-diagnostiquées et sous-étudiées chez les femmes, et les taux de traitement auprès de ces dernières sont inférieurs à ceux des hommes. La Dre Gabriela Ghisi de l’Institut de recherche KITE espère combler cet écart dans les soins des maladies cardiovasculaires grâce à une méthode efficace appelée réadaptation cardiovasculaire. Elle consiste pour les patients à suivre un modèle de soins préventifs économique offert hors du milieu hospitalier pour apporter des changements à leur mode de vie et ainsi prévenir la progression des maladies cardiovasculaires, en réduire le taux de morbidité et de mortalité de 20 % et diminuer le risque de réhospitalisation. La réadaptation cardiovasculaire sera offerte par l’entremise du Cardiac CollegeMC, une entité de la Health e-University (une ressource publique en ligne qui héberge des outils pour la prise en charge des maladies chroniques). Le programme de sensibilisation des patients de la Health e-University représentant le seul outil fondé à la fois sur la théorie et les données probantes à la disposition des patients en réadaptation cardiaque à l’échelle mondiale, la Dre Ghisi souhaite également évaluer la facilité d’utilisation, l’efficacité et la mise en pratique d’autres outils éducatifs accessibles en ligne actuellement qui sont conçus pour aider les femmes à améliorer leur santé cardiovasculaire. De plus, elle continuera à inclure davantage de femmes à titre de patientes partenaires dans les études cliniques afin de favoriser l’équité des genres dans le domaine des connaissances sur les maladies cardiovasculaires. Pour atteindre ses objectifs de recherche, la Dre Ghisi travaille de pair avec une équipe composée des personnes suivantes : Dr Paul Oh, Dre Sherry Grace, Dre Tracey Colella, Andree-Anne Hebert, Dre Marie-Kristelle Ross, Crystal Aultman et Dre Tara Sedlak. Lectures complémentaires |

Un portail pour les jeunes aux prises avec des douleurs chroniquesDes soins sur demande pour une jeunesse épanouie Dre Jennifer Stinson, chercheuse principale désignée La douleur chronique touche un jeune sur cinq et a des effets dévastateurs sur les familles. Or, les recherches menées par la Dre Tieghan Killackey, la Dre Jennifer Stinson, Melanie Noel et Katie Birnie, ainsi que l’équipe COVIDChildPain (fournisseurs de soins pédiatriques contre la douleur, chercheurs, patients et familles), ont démontré que la COVID-19 a érigé des barrières à l’accès aux soins pour la douleur chronique. Pour résoudre ce problème, les « soins par paliers » se sont avérés particulièrement prometteurs : ils permettent aux jeunes de personnaliser leurs soins en fonction de leurs besoins et de leurs préférences et leur donnent les moyens de gérer eux-mêmes leur douleur grâce à des ressources dignes de confiance. C’est donc en collaboration avec des jeunes de tout le Canada qu’a été créé le portail « Surmonter sa douleur ». Son but : améliorer l’accès des jeunes à des soins fondés sur des données probantes pour le traitement de la douleur. Titulaire de la chaire en soins infirmiers pédiatriques Mary-Jo-Haddad et scientifique chevronnée du Programme des sciences évaluatives de la santé des enfants à l’Hôpital pour enfants de Toronto (SickKids), la Dre Jennifer Stinson est la chercheuse principale, c’est-à-dire la responsable, de l’iOuch Lab, qui vise à améliorer la vie des enfants et des adolescents vivant avec la douleur grâce à des technologies de la santé numériques innovantes et à la mobilisation des patients et des familles. La vidéo réalisée sur le sujet a valu à la Dre Stinson une mention spéciale lors du concours Entretiens de l’IDSEA 2022. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Entretiens de l'IDSEA pour visionner les vidéos soumises et renseignez-vous sur le concours annuel. Lectures complémentaires
|

Transition des soins pédiatriques aux soins pour adultesEfficacité des intervenants pivots lors de la transition des soins pédiatriques aux soins pour adultes Megan Patton; Zoya Punjwani La transition des services pédiatriques aux services pour adultes peut s’avérer difficile pour les jeunes atteints de maladies chroniques ou de problèmes de santé mentale. Cette période de transition, qui commence avant l’âge adulte, peut entraîner de nombreuses visites aux urgences, une diminution de la fréquence des consultations médicales et des difficultés à gérer les problèmes de santé. Notre étude, baptisée Transition Navigator Trial, porte sur les moyens de faciliter la transition vers les soins pour adultes. Elle fait appel à des intervenants pivots pour aider les jeunes atteints de maladies chroniques, comme l’autisme, l’insuffisance rénale chronique ou le diabète, à passer de leur pédiatre à un nouveau médecin. Ce service aide les jeunes à divers points de leur transition, notamment en les préparant au transfert des soins, en leur donnant les moyens d’obtenir les soins dont ils ont besoin en tant qu’adultes et en réduisant les barrières sociales et financières qui peuvent rendre difficile l’accès aux soins médicaux. Grâce à cet essai, un service d’intervenants pivots a été mis sur pied de manière permanente dans chacun de nos sites de recrutement. Résultat : tous les jeunes de l’Alberta qui font la transition vers des soins spécialisés pour adultes pourront bénéficier d’un tel service. La vidéo réalisée sur le sujet a remporté la troisième place au concours de vidéo Entretiens de l’IDSEA 2022. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Entretiens de l'IDSEA pour visionner les vidéos soumises et renseignez-vous sur le concours annuel. Lectures complémentaires |
Accroître l’accès à des échantillons biologiques de qualité supérieure pour améliorer la recherche en santéCréation d’une filière d’échantillons biologiques pour propulser la recherche en santé au Canada 
Les données de 40 % des publications de recherche ont été obtenues à partir d’échantillons biologiques, notamment de tissus et de sang, provenant de quelque 10 000 biobanques de recherche en santé (collections de laboratoires, études cliniques et référentiels spécialisés) qui stockent des millions d’échantillons et de produits dérivés. Toutefois, pour diverses raisons, les chercheurs peinent encore à trouver des échantillons biologiques de bonne qualité pour leurs travaux. Les ressources des biobanques sont fragmentées, et les bailleurs de fonds financent souvent des collections en double ou de mauvaise qualité. Par conséquent, la recherche est limitée et inefficace, et la reproductibilité, incertaine. Le Dr Watson est clinicien-chercheur à l’organisme BC Cancer; il conjugue sa pratique clinique comme pathologiste du sein avec la recherche sur le cancer. À titre de coresponsable du CTRNet, il a participé à l’établissement de normes, de programmes éducatifs et d’outils valorisant l’utilisation efficace des biobanques. Le CTRNet propose une stratégie globale pour accroître l’accès aux échantillons biologiques, en améliorer la qualité et celle des données et créer une filière moderne d’échantillons biologiques pour la recherche à l’échelle nationale. À l’instar du domaine des données, les programmes du CTRNet reposent sur l’application des principes FAIR (faciles à trouver, accessibles, interexploitables et réutilisables) aux échantillons biologiques et aux données connexes pour permettre aux scientifiques de poursuivre leurs recherches le plus efficacement possible. À ce jour, près de 400 biobanques canadiennes appuyant la recherche en santé dans les domaines d’intérêt des 13 instituts des IRSC se sont inscrites aux programmes d’assurance de la qualité du CTRNet et ont adopté ses normes et ses outils. Les ressources du CTRNet ont également largement été utilisées par les biobanques de plus de 20 pays. En reconnaissance de son travail exceptionnel, le Dr Watson a reçu en 2023 le prix Outstanding Achievement in Biobanking de l’International Society for Biological and Environmental Repositories. Lectures complémentaires |

L’activité physique chez les enfants durant la pandémie de COVID-19Monika Szpunar, M. Sc. Monika travaille au sein du Laboratoire de la santé et de l’activité physique des enfants de la Dre Tucker depuis 2018. Situé à l’Université Western, ce laboratoire offre un environnement propice à la formation et à la recherche et est spécialisé dans l’étude et la promotion de facteurs susceptibles d’influer sur l’activité physique et la sédentarité des jeunes enfants. Après avoir axé son mémoire de maitrise sur la mise en application d’une politique comportementale visant l’activité physique et la sédentarité des enfants en bas âge en milieu éducatif, Monika consacre sa recherche doctorale aux effets de la pandémie de COVID-19 sur l’activité physique des enfants et de leurs parents. L’importance accordée au regard des enfants, qui est souvent absent des études menées, permettra aux résultats de ses travaux d’enrichir le corpus de données sur la COVID-19. La vidéo réalisée sur le sujet a valu à Monika une mention spéciale lors du concours Entretiens de l'IDSEA 2022. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Entretiens de l'IDSEA pour visionner les vidéos soumises et renseignez-vous sur le concours annuel. |

Rien de tel qu’évacuer en toute sérénité!Créer des ressources éducatives pour les enfants aux prises avec une maladie rare Dre Argerie Tsimicalis L’ostéogenèse imparfaite, également appelée « maladie des os de verre », est une maladie génétique rare qui se caractérise par une extrême fragilité des os. Les enfants qui combattent la maladie subissent parfois des fractures nécessitant une intervention chirurgicale qui les expose à un risque de constipation, une situation pour le moins déplaisante, difficile à aborder et qui peut être embarrassante, d’autant plus que ce risque est plus grand chez les enfants à mobilité réduite que chez le reste de la population. Pour remédier à cette situation, la Dre Argerie Tsimicalis et son équipe de recherche à l'Hôpital Shriners pour enfants du Canada tentent de comprendre le ressenti des enfants vivant avec une maladie rare dans la perspective de créer et de mettre au banc d'essai de nouvelles ressources qui aideront ces enfants et leur famille sur plusieurs plans : comprendre les informations qui figurent dans leur dossier de santé, exprimer leurs besoins, prendre part aux décisions qui les concernent, gérer leur maladie, et contribuer à améliorer la qualité des soins. Les conseils de l'équipe pour « évacuer en toute sérénité » après une intervention chirurgicale feront prochainement l'objet d'une série de vidéos animées qui s'accompagneront d'un livre à colorier (« OI Colour, OI Learn » aux éditions Tellwell). Pour mener à bien le projet, l'équipe a pu compter sur l'artiste conceptuelle Miranda Harrington, sur l'animatrice Stephanie Smith, sur le musicien Mika Zahar et sur la Dre Gisel Martins, chercheuse invitée de l'Université de Brasilia, qui a participé aux travaux de recherche sur les affections vésicales et intestinales que les enfants aux prises avec une ostéogenèse imparfaite sont susceptibles de présenter. La vidéo réalisée sur le sujet a valu à la Dre Tsimicalis une mention spéciale lors du concours Entretiens de l'IDSEA 2022. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Entretiens de l'IDSEA pour visionner les vidéos soumises et renseignez-vous sur le concours annuel. Lectures complémentaires
|
Activité physique et santé mentale : piste de solution pour les jeunes adultes atteints de diabète de type 1
Le quotidien des adolescents atteints de diabète de type 1 est rythmé par la surveillance et la gestion de leur glycémie, alors même qu'ils traversent une période de développement cruciale. Résultat : leur qualité de vie et leur santé mentale en souffrent. Devant ce problème de taille, le Dr Jonathan McGavock, de l'Université du Manitoba, cherche à savoir si l'exercice peut réduire le stress et l'anxiété de ces adolescents, tout en rehaussant leur qualité de vie. Pour ce faire, des jeunes âgés de 13 à 17 ans sont invités à prendre part à une intervention de 12 semaines dirigée par des pairs mentors menant une vie active. Le but est de déterminer si une intervention éclairée par le vécu de jeunes adultes vivant avec le diabète de type 1 — les pairs mentors — incitera les adolescents à faire davantage d'activité physique et les aidera ainsi à surmonter les problèmes de santé mentale attribuables à l'autogestion du diabète. Si l'essai s'avère une réussite, il pourrait mener à de nouveaux traitements cliniques axés sur le patient qui aideront les jeunes diabétiques à bouger plus et à vivre mieux. Lectures complémentaires |
Vers un Canada en meilleure santé : les bienfaits de la recherche sur le microbiomeDes scientifiques se penchent sur les bactéries intestinales favorables à la santé chez l’humain 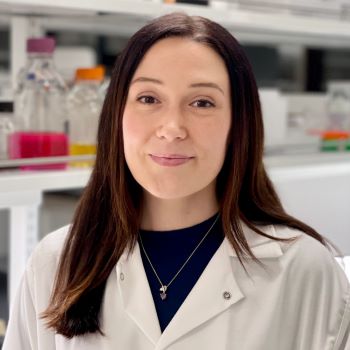
Des études montrent que la bactérie intestinale Akkermansia muciniphila nous protège contre l’obésité liée au régime alimentaire et les troubles neurologiques, en plus d’améliorer les réactions aux traitements anticancéreux. Or, malgré ces découvertes prometteuses, ce microbe est toujours entouré de mystère, d’autant plus qu’on n’a trouvé aucun autre microbe étroitement apparenté à Akkermansia chez l’humain. Devant les grandes possibilités thérapeutiques qu’offre Akkermansia muciniphila, l’équipe de la Dre Lauren Davey, professeure adjointe de biochimie et de microbiologie à l’Université de Victoria, cherche à percer le mystère de cette bactérie, notamment ses interactions avec l’hôte humain et les autres membres du microbiome. « Il est essentiel de mener des recherches fondamentales sur le microbiome, en se concentrant sur des microbes en particulier et leurs activités dans l’intestin, afin d’exploiter le microbiome au profit de la santé humaine, » explique la Dre Davey. En élucidant le fonctionnement d’Akkermansia, la Dre Davey et son équipe comptent renforcer l’arsenal génétique qui permettra de pousser encore plus loin les recherches sur cette bactérie et de mettre en valeur ses propriétés bénéfiques, par exemple grâce au génie génétique. En définitive, la Dre Davey espère que ses recherches contribueront à la mise au point de probiotiques sûrs et efficaces à base d’Akkermansia pour améliorer la santé métabolique et accroître la longévité. Lectures complémentaires |
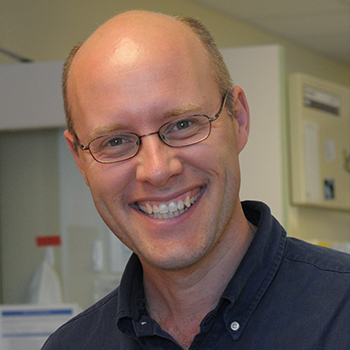
Pour des recherches qui répondent aux besoins des enfants atteints d’une maladie inflammatoire de l’intestinLes patients et leur famille ont des pistes de réflexion à ajouter aux idées des cliniciens Dr Anthony Otley (M.D., FRCPC, M. Sc.) Comme pour de nombreuses maladies, la recherche sur les maladies inflammatoires de l’intestin (MII) chez l’enfant se fait sous l’impulsion des chercheurs et de l’industrie. Résultat : certaines questions de recherche particulièrement déterminantes pour nos patients, leur famille et les cliniciens risquent d’être ignorées. Pour remédier à cette situation, le Canadian Children IBD Network (CIDsCaNN; Réseau canadien sur les MII chez l’enfant) mise sur l’établissement concerté des priorités de recherche afin de poser les jalons d’un programme durable de mobilisation des patients. À l’aide d’un processus de recherche bien connu de la James Lind Alliance (JLA), l’équipe du Dr Otley a tenté de cerner ces questions laissées sans réponse en sollicitant les opinions de patients, de familles, de médecins, de professionnels paramédicaux et de représentants des organisations nationales pertinentes. Elle a ainsi recueilli des milliers de questions du public dans le cadre d’une enquête nationale et les a classées par ordre d’importance. Les résultats de cette étude a aidé l’équipe à établir ses dix grandes priorités de recherche, ainsi que les trois principales questions auxquelles la recherche a déjà répondu. Pour faire connaître ces résultats, le Dr Otley s’est associé à de talentueux animateurs-graphistes pour créer des vidéos destinées à une large diffusion. Une de ces vidéos a reçu une mention spéciale lors du concours de vidéos Entretiens de l’IDSEA de 2022. Visitez la chaîne YouTube Entretiens de l'IDSEA pour visionner toutes les vidéos soumises ou rendez-vous à la page Web du concours pour en savoir plus. Lectures complémentaires
|

Faire résonner la voix du patientTransformer les soins par l’intégration des mesures des résultats déclarés par les patients dans la pratique clinique Dr. Samantha J. Anthony L’objectif global du laboratoire Anthony est d’examiner l’incidence biopsychosociale des maladies chroniques pédiatriques, en particulier la transplantation d’organes pleins, sur les patients et leur famille afin d’améliorer la santé en transformant la pratique clinique. Cet objectif est atteint :
Les mesures des résultats déclarés par le patient (MRDP) permettent de recueillir des données subjectives sur les soins médicaux du point de vue du patient, lesquelles revêtent de plus en plus d’importance à l’ère des soins centrés sur le patient. Pour intégrer les MRDP dans la pratique clinique courante, la Dre Anthony et ses collaborateurs ont créé une plateforme électronique appelée Voxe à la lumière de recherches fondées sur des données probantes, c’est-à-dire des cycles de conception, des essais de convivialité et des entrevues auprès de patients pédiatriques et de leurs fournisseurs de soins de santé. En transformant la façon dont les soins sont prodigués, Voxe conjugue innovation et créativité pour faire résonner la voix des patients. Une vidéo de ce projet a remporté la première place au concours de vidéos Entretiens de l’IDSEA de 2022. Visitez la chaîne YouTube Entretiens de l’IDSEA pour visionner toutes les vidéos soumises ou rendez-vous à la page Web du concours pour en savoir plus. Lectures complémentaires |
Des cellules souches pour traiter le choc septique, danger majeur aux soins intensifs
Le choc septique est l’une des infections les plus graves observées dans les unités de soins intensifs (USI) : il est impliqué dans le décès d’une personne sur 18 au Canada, et associé à 11 millions de décès par année dans le monde. Comme on peut le constater, le taux de mortalité de ce syndrome, caractérisé par un collapsus cardiovasculaire et une défaillance viscérale, est élevé. Jusqu’à maintenant, aucun traitement n’est parvenu à améliorer le pronostic. Entre en jeu la Dre Lauralyn McIntyre, médecin à l’unité des soins intensifs de l’Hôpital d’Ottawa, qui mène un essai clinique de phase II visant à déterminer si les cellules souches du cordon ombilical réduiront le recours au soutien des fonctions vitales chez un patient en choc septique à l’USI. L’intérêt pour les traitements à base de cellules souches ne cesse de croître, puisque les cellules souches mésenchymateuses (CSM) – facilement cultivables en laboratoire – sont capables de se différencier en n’importe quel type de cellule, une propriété qui offre un large éventail d’applications thérapeutiques. Globalement, les cellules souches aident à réparer les tissus et à réduire l’inflammation en communiquant avec d’autres cellules du corps et en interagissant avec le système immunitaire. La Dre McIntyre dirige une équipe multidisciplinaire d’experts du sepsis, d’experts en essais cliniques, de stagiaires, d’experts en production de cellules souches et de patients et familles partenaires, dont bon nombre ont participé à la première phase de l’essai. L’un des aspects les plus gratifiants de l’essai aux yeux de la Dre McIntyre? La collaboration entre chercheurs chevronnés, nouveaux chercheurs et patients. Bien sûr, rien ne la réjouit autant que la perspective de voir un jour les cellules souches du cordon ombilical servir au traitement du choc septique. S’il est concluant, l’essai de phase II devrait déboucher sur des partenariats internationaux et commerciaux, ce qui contribuera à faire de ce traitement à base de cellules souches une option viable pour tous les patients en choc septique. |
Prédire la neurodégénérence et le déclin cognitif des ainés
L’Alzheimer est une maladie. Elle est donc définie par les marques qu’elle laisse dans le cerveau plutôt que par les symptômes qui en résultent. On suspecte que ce système commence déjà à être dysfonctionnel plusieurs années avant qu’une personne atteinte de l’Alzheimer commence à perdre ses facultés cognitives. Ainsi, on pourrait prédire le déclin cognitif par la détection de l’Alzheimer et la mesure de la progression de la neurodégénérescence qui y serait associée. Étienne Aumont, boursier Vanier à l’Université du Québec à Montréal, entreprend de vérifier cette hypothèse en mesurant la taille des sous-régions de l’hippocampe à l’aide de la neuroimagerie. Plus de 300 ainés sont suivis annuellement au sein de la cohorte TRIAD (translational biomarkers in aging and dementia). Étienne utilisera ces données pour voir si les marqueurs de l’Alzheimer prédisent une neurodégénérescence, et si celle-ci mène à une perte de mémoire. En plus de ses travaux de recherche, Étienne a fondé Sciences 101, un organisme faisant la promotion de l’acquisition de compétences en communication scientifique étudiante depuis début 2019. À travers l’organisme, il a fondé la revue de vulgarisation scientifique la Fibre, un concours de vulgarisation et a organisé de nombreuses formations pour le bénéfice de la communauté étudiante. Lectures complémentaires |
L’application de la médecine de précision à la ventilation mécanique pourrait améliorer le pronostic vital des patients en détresse respiratoire
Au Canada, des dizaines de milliers de personnes souffrent chaque année d’une insuffisance respiratoire aiguë. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) en est la forme la plus sévère et se traduit souvent par une admission en unité de soins intensifs. À ce stade, le taux de mortalité se situe entre 30 et 40 %, une statistique qui traduit la nécessité absolue d’intensifier la recherche dans l’espoir d’améliorer les chances de survie, ce dont le Dr Laurent Brochard, du réseau Unity Health Toronto, est bien conscient. Dans le cadre d’une étude financée par le Fonds pour les essais cliniques intitulée CAVIARDS (Careful Ventilation in Acute Respiratory Distress Syndrome), le Dr Brochard et son équipe mettent au banc d’essai l’hypothèse qu’une programmation personnalisée des systèmes de ventilation mécanique fondée sur des mesures relevées au chevet des patients est susceptible d’améliorer leur pronostic vital et de réduire la durée de la ventilation. Si l’essai s’avère concluant, la généralisation de l’approche augmentera le taux de survie des patients et atténuera les conséquences du contrecoup de la ventilation sur le long terme, notamment sur les poumons et le cerveau. L’essai CAVIARDS s’inspire de la médecine des soins intensifs, qui a pour but d’améliorer le taux de survie et la qualité de vie des personnes admises en unité de soins intensifs, afin de favoriser le rétablissement d’un nombre accru de patients aux prises avec une insuffisance respiratoire. Si dans leur majorité, les essais cliniques sont conçus pour profiter en priorité aux futurs patients, les personnes qui y participent tirent souvent bénéfice de la qualité des soins prodigués. Dans le cas des patients présentant une détresse respiratoire, les bienfaits procurés par une ventilation mécanique adaptée à leurs besoins pourraient même se faire ressentir avant la fin de l’essai. Lectures complémentaires |
Découvrir des façons de traiter les infections du sang pour améliorer les résultats cliniques
Au Canada, plus de 10 000 personnes contractent une infection du sang causée par le staphylocoque doré chaque année. Cette maladie peut entraîner des formes sévères du sepsis, la propagation de la bactérie à d’autres parties du corps, et même la mort. Il s’agit malheureusement d’une des graves infections bactériennes les plus répandues dans le monde. Il existe des traitements antibiotiques contre ce type d’infection, mais les médecins se heurtent souvent à des cas difficiles, et de nombreuses questions subsistent quant aux traitements les plus efficaces. L’essai clinique international S. aureus Network Adaptive Platform (SNAP) vise à évaluer les multiples stratégies de traitement en vue d’améliorer les résultats cliniques des patients atteints de cette affection. Le Dr Todd C. Lee et son équipe vont maintenant plus loin : ils examinent de nouvelles méthodes de traitement dans le cadre d’un nouvel essai clinique, intitulé Expanding the Staphylococcus Aureus Network Adaptive Platform. L’équipe du Dr Lee déterminera d’abord si la céfazoline et l’ertapénème combinés s’avèrent efficaces contre les infections par le staphylocoque doré sensible à la méticilline, le type de staphylocoque doré le plus fréquent. Les chercheurs compareront ensuite les avantages de deux autres antibiotiques actuellement utilisés pour traiter les souches résistantes à la méticilline. Enfin, l’équipe déterminera si la rifampicine, un médicament déjà en usage contre la tuberculose, pourrait ou non être nécessaire pour traiter les personnes ayant une prothèse valvulaire cardiaque. Ce nouveau projet est le fruit d’une collaboration entre des chercheurs de l’Australie, du Canada, de l’Israël, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Royaume-Uni. Le nouvel essai clinique du Dr Lee s’ajoute à la plus grande collaboration internationale visant à mieux comprendre le traitement de cette maladie mortelle. Le Dr Lee a bon espoir qu’au cours des dix prochaines années, ces efforts seront à l’origine de nombreuses innovations dans les soins aux patients et produiront des données probantes exploitables pour éclairer les soins et les traitements de l’avenir. Lectures complémentaires |
Petits pas, grands résultatsDoter les communautés urbaines diversifiées d’un programme de prévention du diabète fondé sur des données probantes 
La Dre Mary Jung est professeure agrégée à l’École des sciences de la santé et de l’exercice de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), sur le campus Okanagan. Ses travaux visent à mettre au point des interventions de prévention du diabète fondées sur des données probantes conçues pour une mise en œuvre et une pérennisation en milieu communautaire, le tout en travaillant à améliorer l’équité, la diversité et l’inclusivité dans toutes les démarches de recherche. Elle a été chercheuse-boursière de la Fondation Michael-Smith pour la recherche en santé en 2015, et est récipiendaire en 2023 de la bourse de recherche Killam Accelerator. La Dre Jung dirige le Groupe de recherche sur la prévention du diabète (en anglais seulement); elle est la fondatrice du programme de prévention du diabète « Small Steps for Big Changes » et directrice du Centre for Health Behaviour Change à l’UBC. La Dre Jung est aussi la chercheuse principale désignée d’un projet financé par une subvention d’équipe des IRSC en science de la mise en œuvre dans le domaine des villes en santé. Intitulé Small Steps for Big Changes: Implementing an Evidence-Based Diabetes Prevention Program into Diverse Urban Communities, ce projet vise à évaluer la mise en œuvre, l’efficacité et la viabilité d’un programme de prévention du diabète dans des collectivités urbaines du Canada et de l’Australie où les taux de diabète de type 2 sont élevés et où les programmes de prévention demeurent inaccessibles. Lectures complémentaires
|
Former la relève canadienne en recherche clinique
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière de sérieuses lacunes dans nos institutions publiques et dans nos industries pharmaceutiques et biotechnologiques. Il apparaît désormais que le Canada doit mettre en place un programme de formation, de perfectionnement et de mentorat coordonné pour améliorer la conception et la mise en œuvre d’essais cliniques. C’est pour remédier à cette situation que le Dr Jean Bourbeau, scientifique principal au Centre de recherche évaluative en santé de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, a créé le Consortium canadien de formation en essais cliniques (FORMCAN). L’équipe de FORMCAN réunit 95 scientifiques de 14 établissements et de 9 provinces qui collaborent avec des partenaires publics et privés. Mais la question se pose : comment le déploiement de la plateforme de formation FORMCAN attire-t-il des scientifiques et des spécialistes hautement qualifiés en recherche clinique et leur permet de progresser? Le Dr Bourbeau et son équipe ont mis au point des outils d’apprentissage en ligne pour favoriser l’avancement de carrière des professionnels de la recherche clinique au Canada, sous la forme de stages, de mentorat, de programmes de réseautage, d’apprentissage par l’expérience et de formations axées sur les compétences avec certification. La plateforme FORMCAN offrira de nombreux volets de formation, comme la conduite d’essais cliniques, la conception et l’analyse d’essais cliniques et le développement de partenariats. Elle veillera ainsi à ce que le Canada demeure une figure de proue de la recherche clinique, mais ce n’est pas tout : elle dotera aussi le pays du personnel hautement qualifié dont il a besoin pour mener des essais cliniques efficaces qui profiteront à toute la population. FORMCAN est l’une des sept plateformes de formation soutenues par le Fonds pour les essais cliniques. Ces initiatives de collaboration permettent de former la relève en recherche clinique dans des spécialités comme la biostatistique, la recherche sur les accidents vasculaires cérébraux, la modification de comportement, ainsi que la pratique générale de la recherche clinique. Lectures complémentaires |
Un traitement contre l’arthrite pourrait s’avérer bénéfique pour les personnes atteintes de mucopolysaccharidoses
Les mucopolysaccharidoses forment un groupe de maladies rares qui toucheraient une naissance sur 25 000. Les personnes qui en sont atteintes naissent sans l’enzyme responsable de la dégradation des glucides complexes appelés glycosaminoglycanes. Au fil du temps, les glycosaminoglycanes s’accumulent dans l’organisme et provoquent de l’inflammation, de la douleur et de la raideur articulaires, des anomalies squelettiques et, dans certains cas, des troubles cognitifs. Il existe néanmoins des traitements qui permettent d’allonger l’espérance de vie des personnes atteintes. En tant que généticien-biochimiste en pédiatrie, le Dr John James Mitchell travaille depuis plus de 20 ans avec des enfants atteints de maladies génétiques rares. Il a toujours été impressionné par la résilience des patients et de leur famille, malgré les défis que des maladies comme les mucopolysaccharidoses peuvent apporter. Le Dr Mitchell est maintenant à la recherche de traitements supplémentaires pouvant les aider dans leur parcours. L’un de ces traitements prometteurs est le médicament appelé adalimumab, dont les propriétés analgésiques et anti-inflammatoires ont été démontrées dans un essai clinique américain axé sur l’arthrite. Or, des études préliminaires et des données anecdotiques semblent indiquer que l’adalimumab pourrait offrir des bienfaits similaires aux personnes atteintes de mucopolysaccharidoses. L’essai clinique randomisé du Dr Mitchell, intitulé « The Safety and Efficacy of Adalimumab for Pain Reduction in Individuals with Mucopolysaccharidoses » [L’innocuité et l’efficacité de l’adalimumab pour atténuer la douleur chez les personnes atteintes de mucopolysaccharidoses], apportera des réponses sur l’innocuité et les bienfaits de l’adalimumab comme traitement potentiel des mucopolysaccharidoses de types I, II, IVA et VI. Son équipe est en train d’évaluer les effets du médicament sur la douleur, la qualité de vie, l’amplitude des mouvements articulaires et d’autres variables. Le Dr Mitchell a bon espoir que le traitement par l’adalimumab réduira la douleur et l’inflammation et, par conséquent, améliorera la qualité de vie de ceux et celles qui vivent avec des mucopolysaccharidoses. D’ailleurs, le fait que cet essai est mené au Canada permettra à la population canadienne d’avoir accès au traitement après son approbation. Lectures complémentaires |
Une approche ciblée nourrit les espoirs de traitement de la dysplasie ventriculaire droite arythmogène, une maladie cardiaque génétique
La dysplasie ventriculaire droite arythmogène (DVDA) est une maladie cardiaque génétique qui ne présente aucun signe avant-coureur avant un arrêt cardiaque soudain qui peut frapper toutes les tranches d’âge, y compris les personnes jeunes et selon toute vraisemblance en bonne santé. Les décès tragiques d’athlètes sur un terrain ou une patinoire sont souvent causés par la DVDA, et une variante de la maladie à forte prévalence à Terre-Neuve est même surnommée la « malédiction de Terre-Neuve ». Actuellement, aucun traitement efficace n’existe pour traiter la DVDA et le seul recours possible contre une mort subite consiste à implanter un défibrillateur automatique dans le cœur des personnes touchées par la maladie. Les chocs électriques administrés se révèlent néanmoins particulièrement douloureux et peuvent provoquer un traumatisme. La pose d’un tel dispositif implique en outre une adaptation du mode de vie, notamment l’arrêt d’activités sportives susceptibles d’accélérer la progression de la maladie. Dans le cadre d’une nouvelle étude nommée TaRGET, le Dr Jason Roberts, scientifique à l’Institut de recherche sur la santé des populations (en anglais seulement) de l’Université McMaster et spécialiste en arythmie cardiaque génétique, met au banc d’essai un traitement prometteur contre la maladie qui repose sur un médicament appelé tideglusib. Accompagné de son équipe, il a découvert que le tideglusib est capable de prévenir l’apparition de la DVDA chez les souris et même d’enrayer partiellement la progression maladie. Avec le soutien du Fonds pour les essais cliniques, l’équipe examine ainsi le potentiel du tideglusib dans le cadre d’un essai clinique. Si les promesses se confirment, le médicament pourrait rendre la pose d’un défibrillateur facultative et permettre aux personnes touchées par la maladie d’éviter les complications provoquées par le dispositif et de poursuivre le cours de leur vie. Au Canada, le réseau national Hearts in Rhythm Organization œuvre déjà à la transformation des soins prodigués aux patients présentant une DVDA, et ses membres et partenaires à travers le pays participeront à TaRGET. L’essai sera mené en collaboration avec l’Institut de recherche sur la santé des populations de l’Université McMaster ainsi que le Centre des sciences de la santé de Hamilton, qui possède une solide expérience dans la réalisation d’essais cliniques pivots de médicaments dans le domaine de la cardiologie. Le Dr Roberts espère que les avancées dans la mise au point de traitements se traduiront par une amélioration substantielle de la qualité de vie des personnes aux prises avec une maladie cardiaque génétique. Lectures complémentaires |

Adapter l’approche ATTACH™ pour l’attachement et la santé des enfants afin d’en accroître l’accessibilitéUne appli pour promouvoir l’harmonie des relations parents-enfants ainsi que la santé mentale et le développement des enfants Dre Nicole Letourneau et l’équipe ATTACH™ ATTACH™ est un programme éprouvé de psychoéducation parentale conçu pour aider les parents confrontés à l’adversité (p. ex. violence familiale, dépression, pauvreté) à promouvoir la santé mentale et le développement de leurs enfants d’âge préscolaire. Couronné « projet à la frontière de l’innovation » par le Centre du développement de l’enfant de l’Université Harvard, ATTACH™ s’est fait remarquer pour son action inédite sur la santé mentale et le développement des enfants par le renforcement de la capacité de réflexion des parents (c. à d. conscience de leurs pensées et sentiments et de ceux de leurs enfants). ATTACH™ exerce aussi un effet positif sur les sentiments de sécurité et d’attachement des enfants ainsi que sur l’expression génique des cellules immunitaires liées à l’inflammation chez les enfants. À la suite d’un essai pilote réussi de l’appli en ligne, nous proposons de la tester, de la mettre à l’échelle et de la déployer en Alberta par le biais de dix organismes, à savoir huit refuges pour femmes desservant mères et enfants victimes de violence familiale, un organisme au service des parents et des enfants éprouvant des problèmes de santé mentale, et un organisme au service des mères adolescentes à faible revenu et de leurs nourrissons. Lectures complémentaires Twitter: |

Briser le cycle : évaluation et mise en œuvre d’un programme d’intervention précoce auprès d’enfants exposés à l’adversitéUn programme de soutien à la relation mère-enfant pour les mères faisant usage de substances psychoactives Dre Nicole Racine Au Canada, un enfant sur trois est exposé à l’adversité, comme l’abus, la négligence et la violence familiale, expériences qui sont particulièrement préjudiciables puisque les fondements de la santé mentale sont établis pour la vie entière durant la petite enfance. « Briser le cycle » est un programme primé et unique en son genre au Canada qui dessert les mères consommatrices de substances psychoactives et leurs jeunes enfants à risque de vivre des expériences défavorables, et qui s’intéresse plus précisément à la santé mentale des enfants et à la relation mère-enfant. Codirigée par les Dres Debra Pepler et Margaret Leslie, cette équipe de recherche vise à comprendre si « Briser le cycle » favorise une bonne santé mentale chez les tout-petits, et si le programme se traduit par des économies à long terme. L’équipe concevra aussi des stratégies pour la mise à l’échelle du programme et son introduction dans d’autres communautés. Non seulement ce projet contribuera-t-il à l’amélioration de la santé mentale des enfants faisant face à l’adversité, mais il fera aussi du Canada une figure de proue dans le domaine. Lectures complémentaires Twitter: |
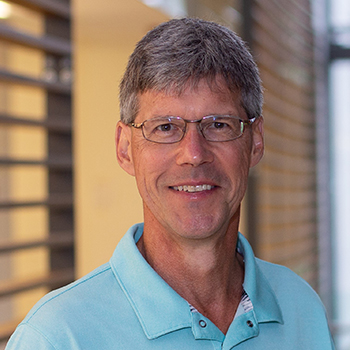
Il faut tout un village pour élever un enfantDévelopper les capacités en santé mentale au profit des tout-petits Dr James N. Reynolds Le Canada est dépourvu d’une approche systématique pour répondre aux besoins de santé mentale des jeunes enfants et de leur famille. Bien souvent, les professionnels de la santé n’arrivent pas à détecter les signes de vulnérabilité chez les tout-petits car ils ignorent à quoi porter attention, et les familles doivent se démener pour trouver du soutien en santé mentale pour leurs enfants. Qui plus est, les risques liés au développement qui passent inaperçus durant la petite enfance peuvent évoluer en problèmes de comportement et de santé mentale dont le traitement nécessitera beaucoup d’efforts de la part des enfants, de leur famille et des services communautaires. Des décennies de travail dirigé par l’organisme Infant and Early Mental Health Promotion (IEMHP) et ses partenaires ont permis de mobiliser des organismes de divers secteurs ainsi que des dirigeants communautaires et des familles afin de développer les capacités d’intervention auprès des nourrissons et des jeunes enfants dont la santé mentale est précaire. L’IEMHP a d’ailleurs conçu un modèle communautaire de développement des capacités visant à intégrer les soins de santé mentale pour les nourrissons et les jeunes enfants aux services de santé et d’éducation et aux services sociaux existants. Notre recherche prendra appui sur une intervention communautaire appelée « Infant and Early Mental Health Care Pathways » et vérifiera l’hypothèse voulant que la mise en application du modèle de l’IEMHP et de ses outils d’évaluation connexes se traduise par la création, l’amélioration, voire l’élargissement de services communautaires de promotion de la santé mentale ainsi que de prévention et de traitement de la maladie mentale au début de la vie. Lectures complémentaires
Twitter: |

D’une génération à l’autre : promouvoir la santé mentale par une intervention de cybersanté communautaire hybrideUne appli combinée à un réseau d’organismes communautaires vise à traiter la maladie mentale des parents, à renforcer le soutien social et à prévenir les problèmes de santé mentale et de développement chez les enfants. Dre Leslie E. Roos Laissée sans traitement, la maladie mentale d’un parent peut nuire aux jeunes enfants en les exposant à des facteurs de stress comme la violence et les problèmes relationnels. La Dre Roos et son équipe ont créé un programme fondé sur une application appelée BEAM (Building Emotional Awareness and Mental Well-Being) pour soutenir la santé mentale des familles à l’aide de vidéos éducatives, de rencontres de groupe, de forums de soutien et de la surveillance des symptômes de mauvaise santé mentale. L’appli BEAM est conçue pour améliorer le bien-être d’une génération d’enfants nés de parents soumis à un stress élevé durant une pandémie mondiale. Jusqu’à présent, BEAM s’avère prometteuse pour aider les parents à surmonter leurs défis et améliorer les relations parents-enfants. On s’attend à ce que BEAM, une fois introduite dans la communauté, contribue à prévenir les problèmes de santé mentale et de développement chez les enfants. Cela sera vérifié dans le cadre d’un essai clinique pragmatique où BEAM sera offerte en collaboration avec Family Dynamics, un important organisme communautaire de Winnipeg. La Dre Roos et son équipe surveilleront le déploiement du programme et évalueront son efficacité à prévenir la parentalité intransigeante et à améliorer la santé et le développement des enfants ainsi que leur préparation à la vie scolaire. Ce modèle de partenariat comporte une stratégie de déploiement de BEAM à grande échelle au Canada de façon à en faciliter l’accès à ceux qui en ont le plus besoin. La Dre Roos se réjouit de pouvoir contribuer à l’épanouissement des enfants et des familles durant la période postpandémique et au-delà. Lectures complémentaires Twitter: |

Mettre au point des méthodes ancrées dans la culture pour comprendre la santé mentale des enfants autochtonesDre Melissa Tremblay Le besoin d’investissement dans la petite enfance est flagrant au sein de la population autochtone (c.-à-d. des Premières Nations, inuite et métisse) du Canada. Pour veiller au développement sain des enfants autochtones, il nous faut conjuguer les efforts d’innovation des communautés avec la recherche scientifique, et reconnaître fondamentalement que les peuples et les communautés autochtones possèdent les connaissances nécessaires à l’amélioration de l’état de santé de leurs enfants. De plus, pour assurer l’efficacité des programmes de la petite enfance, nous avons besoin d’outils d’évaluation et de dépistage qui tiennent compte de la conception de la santé mentale au sein des communautés et de la culture autochtones. Notre projet prend appui sur un partenariat entre le milieu universitaire de la recherche et le programme La petite enfance, lequel est issu d’une étroite collaboration entre l’Initiative de la famille Martin et les communautés autochtones de partout au Canada et a pour but d’aider les enfants à développer leur potentiel. En partenariat avec les programmes de la petite enfance de l’Alberta, du Yukon et du Nunavut, le projet a deux objectifs : 1) examiner les facteurs de réussite des programmes de la petite enfance dans les communautés autochtones, afin d’aider à jeter les bases favorables à la santé mentale des enfants; 2) collaborer à la création d’outils permettant d’évaluer la mise en œuvre de programmes de la petite enfance axés sur les priorités des communautés autochtones en matière de santé mentale des enfants. Lectures complémentaires |

Promouvoir la santé mentale des plus jeunes d’entre nousCarrefour de développement et d’échange de connaissances en promotion de la santé mentale durant la petite enfance La Dre Alice Schmidt Hanbidge La Dre Colleen McMillan Les preuves continuent de s’accumuler sur l’influence déterminante qu’exercent les cinq premières années de la vie sur la santé mentale durant la vie entière. D’ailleurs, la collaboration avec les familles, les communautés et les gouvernements s’avère efficace pour assurer aux jeunes enfants des conditions de développement optimales en vue d’une bonne santé mentale à long terme. Cependant, nous en savons trop peu sur des questions comme le type de soutien à offrir aux enfants selon le contexte, la culture et la région géographique dans lesquels ils grandissent. C’est dans cette optique que les IRSC financent la recherche en science de la mise en œuvre aux quatre coins du pays dans le cadre de l’Initiative sur la santé mentale durant la petite enfance. Les équipes financées sont appelées à collaborer avec le Carrefour de développement et d’échange de connaissances (Carrefour DEC), qui a pour rôle de soutenir des projets de promotion de la santé mentale et de prévention de la maladie mentale, afin de transmettre les nouvelles connaissances aux familles, aux communautés, aux soignants, aux responsables de programme, aux autres chercheurs et aux gouvernements. Le Carrefour DEC favorisera l’apprentissage collectif des équipes et les mettra en contact avec d’autres personnes partageant leurs intérêts, pour ainsi stimuler la production de connaissances dans toutes les équipes. Par son soutien, le Carrefour DEC amplifiera les retombées des projets de recherche sur la santé mentale durant la petite enfance et contribuera tangiblement à la santé mentale des plus jeunes d’entre nous, dans l’immédiat et à long terme. Lectures complémentaires
Twitter: |
L’espoir d’un vaccin contre l’infection à streptocoque du groupe A pour prévenir les maladies graves chez les enfants
L’angine streptococcique est loin d’être rare chez les enfants, mais elle peut rapidement devenir suffisamment grave pour entraîner l’hospitalisation. Une infection à streptocoque du groupe A (Streptococcus pyogenes) peut même menacer la vie du patient, risque que le Dr Michael Hawkes, médecin spécialisé en maladies infectieuses pédiatriques de l’Université de l’Alberta, connaît très bien. Le Dr Hawkes et son équipe ont donc lancé une étude de phase 1 sur deux nouveaux vaccins faisant appel à des peptides (petites protéines) qui produisent des anticorps pour lutter contre les infections à streptocoque du groupe A. L’équipe cherche à évaluer l’innocuité de ces vaccins et la réaction immunitaire qu’ils suscitent chez des volontaires en bonne santé. Il n’existe actuellement aucun vaccin pour prévenir les maladies causées par ces bactéries. Or, sans traitement adéquat, l’infection à streptocoque du groupe A peut se transformer en fièvre rhumatismale, en infection du sang ou en maladie dévoreuse de chair. De toute évidence, un vaccin contre cette infection permettrait d’éviter des maladies graves chez les enfants canadiens. Qui plus est, la fièvre rhumatismale est une cause majeure de problèmes cardiaques à l’échelle planétaire : la prévention de cette infection est donc un objectif de santé publique important qui dépasse nos frontières. L’étude du Dr Hawkes compte une trentaine de participants, et d’autres études suivront une fois que l’innocuité et l’utilité des vaccins auront été établies. L’objectif ultime est de mettre au point un vaccin qui peut être largement utilisé pour prévenir les maladies causées par les streptocoques du groupe A chez les enfants. Lectures complémentaires |
L’œsophagectomie est-elle évitable en cas de carcinome épidermoïde de l’œsophage?Améliorer la qualité de vie après le traitement d’un cancer de l’œsophage 
L’œsophage est le tube musculaire qui permet le passage des aliments et des liquides de la gorge à l’estomac. Comme d’autres tissus, organes ou structures du corps, l’œsophage n’est pas à l’abri du cancer. En fait, le cancer de l’œsophage est le septième cancer en importance et la sixième cause de décès par cancer. Le carcinome épidermoïde de l’œsophage représente 90 % des cas dans le monde. Le traitement curatif, qui consiste pour les cancérologues à se débarrasser définitivement du cancer, est toutefois controversé : les patients subissent généralement une association de chimiothérapie et de radiothérapie suivie d’une œsophagectomie, c’est-à-dire l’ablation partielle ou totale de l’œsophage. Or, l’œsophagectomie nuit à la qualité de vie et les données scientifiques actuelles n’ont pas permis de déterminer si elle est vraiment nécessaire. Radio-oncologue au Centre de cancérologie Princess Margaret du Réseau universitaire de santé et professeure adjointe à l’Université de Toronto, la Dre Jelena Lukovic fait partie de l’équipe qui dirige l’essai randomisé NEEDS. D’envergure internationale, cet essai a pour but de comparer les résultats d’une chimioradiothérapie suivie d’une œsophagectomie à ceux d’une chimioradiothérapie définitive accompagnée d’une surveillance et, au besoin, d’une intervention chirurgicale dite « de sauvetage » visant à retirer les cellules cancéreuses restantes. L’essai vise également à déterminer si la qualité de vie liée à la santé est supérieure en évitant l’œsophagectomie chez une proportion de patients. La Dre Lukovic et ses collègues s’attendent à ce que les résultats soient largement cités et qu’ils constituent le fondement de lignes directrices canadiennes et étrangères sur le traitement du carcinome épidermoïde de l’œsophage. Lectures complémentaires |
Mieux traiter la douleur aiguë chez les enfantsUn clinicien-chercheur de l’Université McMaster mène un essai clinique pour déterminer si un médicament non opiacé peut être aussi efficace que la morphine pour soulager la douleur tout en causant moins d’effets secondaires chez les enfants atteints d’appendicite 
L’appendicite, une maladie courante chez les enfants au Canada, nécessite souvent une intervention chirurgicale urgente. Les enfants atteints peuvent souffrir de douleurs abdominales aiguës, et c’est pourquoi leur prise en charge est déterminante. Bien qu’il soit fréquent de leur prescrire des opioïdes comme la morphine, les patients qui les consomment s’exposent à de graves risques et à des effets secondaires. Le Dr Mohamed Eltorki, professeur adjoint en pédiatrie et en médecine d’urgence pédiatrique à l’Université McMaster, et ses collègues cherchent à déterminer si le kétorolac – un médicament non opiacé qui réduit l’inflammation et la douleur tout en causant moins d’effets secondaires – s’avère aussi efficace que la morphine pour traiter les enfants atteints d’appendicite. L’équipe de recherche mène un essai contrôlé randomisé multicentrique dans le cadre duquel 600 patients de partout au Canada recevront au hasard une dose de morphine ou de kétorolac. Le Dr Eltorki espère que cette étude produira des données probantes qui guideront les familles et les praticiens dans l’utilisation de médicaments contre la douleur pour les enfants. Lectures complémentaires
|
Médecine de précision pour les autres cancers de l’ovaireLes caractéristiques moléculaires des cancers liés à l’endométriose peuvent être utilisées pour reclassifier les cancers de l’ovaire et pour assurer leur prise en charge directe 
Le meilleur moyen de comprendre les cancers liés à l'endométriose est de mieux comprendre leur origine en ce qui a trait à l'endométriose et aux cellules de l'endomètre. Il s'agit d'un groupe unique de cancers dont l'évolution, la réponse aux traitements et les facteurs de risque héréditaires diffèrent de ceux des cancers de l'ovaire séreux de haut grade plus courants. Le Dr Michael Anglesio, professeur adjoint à l'Université de la Colombie‑Britannique, et son équipe travaillent étroitement avec des cliniciens spécialisés en endométriose pour en savoir plus sur le développement et l'évolution de l'endométriose en tant que maladie chronique avec un potentiel de malignité. Son équipe est l'un des quelques groupes à étudier l'endométriose du point de vue génétique en plus d'être la première équipe à décrire des mutations semblables à celles observées en cas de cancer pour cette affection – même lorsqu'elles ne se transforment pas en cancer. Le Dr Anglesio est un chef de file au sein d'une équipe mondiale qui travaille à constituer un ensemble d'échantillons de carcinomes ovariens associés à l'endométriose qui aidera les chercheurs à mieux comprendre comment ces cancers évoluent. Son équipe est déjà parvenue à définir quatre sous-catégories qui sont presque identiques à des cancers de l'endomètre. Cette découverte pourrait bientôt mener à des changements dans les traitements offerts aux personnes atteintes d'un cancer associé à l'endométriose, notamment en réduisant le recours à la chimiothérapie toxique pour bon nombre d'entre elles. Même si les cancers associés à l'endométriose sont considérés comme rares, l'endométriose ne l'est pas. Près de 10 % des personnes ayant un utérus peuvent être touchées par l'endométriose et présentent un risque élevé de développer ces cancers. En examinant à la fois les cancers et les lésions précancéreuses, le Dr Anglesio espère venir en aide aux personnes atteintes d'endométriose et à celles touchées par des tumeurs malignes connexes. Lectures complémentaires
|
Les médecins nettoient vos plaies chirurgicales, certes, mais le choix de solution – iodée ou saline – donne toujours lieu à un vif débat.
Il semble évident qu’il faut nettoyer les incisions chirurgicales, mais le moment approprié pour le faire, la meilleure façon de procéder et le type de solution à utiliser varient au Canada, et même au sein des établissements. Dans le cadre de son essai clinique, intitulé CLEAN Wound, le Dr Paul Karanicolas déterminera si l’irrigation (le nettoyage) des incisions chirurgicales peut réduire les risques d’infection du champ opératoire. Les infections représentent un fardeau pour les patients et le système de soins de santé, provoquent d’autres problèmes de santé et prolongent les séjours à l’hôpital. Cela dit, l’irrigation, une intervention simple et peu coûteuse, pourrait améliorer l’état de santé des patients. Le Dr Karanicolas comparera une solution de polyvidone iodée (un antiseptique) et une solution saline sans irriguer la plaie, puis mesurera les résultats après 30 jours. Grâce à l’appui financier du Fonds pour les essais cliniques, l’essai CLEAN Wound sera mis en place dans huit centres communautaires et universitaires en Ontario. Le Dr Karanicolas a bon espoir que son essai clinique permettra de résoudre les incertitudes entourant l’irrigation des plaies du champ opératoire, et, ainsi, de rehausser les normes de soins pour tous les patients au Canada et ailleurs dans le monde. |
Impossible de traiter l’inconnuUne chercheuse de l’Université de Toronto vise à comprendre comment les endonucléases reconnaissent et coupent des structures précises de l’ADN et à faire de ces enzymes une cible thérapeutique potentielle pour le traitement du cancer 
Le talon d’Achille des cellules cancéreuses réside dans la détection d’une de leurs faiblesses ou vulnérabilités caractéristiques, qui peut être isolée et exploitée à des fins de traitement du cancer. Parmi ces caractéristiques, mentionnons la prolifération et la croissance incontrôlées des cellules qui, en raison des erreurs de réplication, de l’exposition à des composés nocifs et du stress oxydant, aggravent les dommages provoqués à l’ADN. Les cellules normales peuvent réparer ou éliminer l’ADN endommagé, mais les cellules cancéreuses présentent souvent des mutations des gènes qui régulent ce processus. S’ensuit une augmentation des dommages induits à l’ADN, des anormalités dans les structures de l’ADN et de l’instabilité du génome. Grâce à l’obtention d’une subvention Projet des IRSC, la Dre Haley Wyatt de l’Université de Toronto étudie comment les endonucléases reconnaissent et coupent des structures aberrantes précises de l’ADN pour protéger l’intégrité du génome. Ses approches expérimentales et très complémentaires s’inscrivent dans plusieurs domaines, notamment la biochimie, la biologie structurale et la biologie moléculaire. La recherche fondamentale de la Dre Wyatt pourrait permettre de déterminer les éléments de ces endonucléases pouvant être mis à profit à des fins thérapeutiques. Lectures complémentaires |
Miser sur l’entraide!Boursière Vanier à l’Université Laval s’est alliée à un organisme communautaire pour explorer comment la communauté et des personnes habitant en appartements supervisés peuvent s’aider mutuellement 
De plus en plus d’organisations mettent sur pied des appartements supervisés pour mieux répondre aux besoins en matière d’habitation de personnes autistes, présentant une déficience intellectuelle et/ou une déficience physique. Ces organisations font toutefois face à plusieurs questionnements : comment créer un milieu soutenant adéquatement les locataires dans leur autonomie? Et comment favoriser leur participation à la communauté dont ils font partie? Malheureusement, peu d’informations sont disponibles dans la littérature scientifique pour répondre à ces grandes questions. Ces questionnements sont partagés par l’organisme communautaire partenaire de ce projet de recherche. À travers des rencontres avec des gens impliqués au sein de cet organisme, nous en sommes venus à l’idée de développer un réseau d’entraide entre les locataires qui habiteront les appartements supervisés, ainsi qu’entre les locataires et d’autres personnes de la communauté. Afin de dégager les éléments clés à réunir pour que le réseau d’entraide réponde bien aux besoins des différents acteurs impliqués et soit pérenne dans le temps, les gens de la communauté et les locataires sont invités à partager leurs idées dans le cadre d’un forum communautaire et d’entrevues individuelles. En plus de contribuer à l’avancement des connaissances, la recherche permettra de renseigner l’organisme partenaire, et tous les autres développant des projets résidentiels similaires, sur le développement de réseaux d’entraide viables entre des locataires autistes, présentant une déficience intellectuelle ou une déficience physique, et les autres membres de la communauté. Le projet pourra ainsi contribuer à la création de milieux résidentiels et de communautés dans lesquels ces personnes peuvent optimiser leur potentiel. Lectures complémentaires |
Les systèmes d’assistance ventilatoire incommodent les patients. Un sédatif déjà utilisé dans les procédures d’intubation pourrait-il améliorer leur confort?
Avant que le recours à une intubation trachéale ou à un système de ventilation mécanique s’impose, le personnel médical connecte la plupart des patients souffrant d’une détresse respiratoire à un système de ventilation non invasive (VNI). Cette aide à la respiration s’apparente dans une certaine mesure à un appareil à pression positive continue contre l’apnée du sommeil dans le sens où une intubation et le déclenchement d’un coma artificiel ne sont pas requis pour assurer la ventilation des poumons. Il s’agit ainsi d’une technique relativement bien tolérée qui limite la durée du séjour des patients en unité de soins intensifs et réduit les risques de pneumonie. Si la VNI est mieux supportée que la ventilation mécanique, le procédé n’est pas pour autant exempt de tout reproche. La pression exercée par le masque sur le visage et le grand volume d’air insufflé rendent en effet le procédé incommodant, à tel point que le personnel médical se voit dans certains cas contraint d’opter pour la ventilation mécanique. La Dre Kim Lewis, spécialiste en soins intensifs à l’Université McMaster, pourrait avoir trouvé une solution à ce problème : la dexmédétomidine, un sédatif déjà utilisé dans les procédures d’intubation qui apaise les patients, soulage leurs douleurs et contribue à réduire le risque de délirium. Dans le cadre d’un essai clinique randomisé en simple insu visant à comparer les effets de la dexmédétomidine par rapport à un placebo, la Dre Lewis espère démontrer que le sédatif accroît la tolérance à la VNI et prévient le recours à l’intubation ou à la ventilation mécanique. Pendant la pandémie de COVID-19, la Dre Lewis a intubé un grand nombre de patients en détresse respiratoire et savait qu’elle devait trouver d’autres moyens de leur venir en aide. Si l’efficacité de la dexmédétomidine se confirme, la VNI sera mieux tolérée par les patients, ce qui permettra de réduire la durée moyenne d’hospitalisation et de réserver l’usage de la ventilation mécanique aux personnes présentant une insuffisance respiratoire aiguë. Lectures complémentaires |
Arrêter la propagation du cancer du poumonUn boursier Vanier à l’Université du Manitoba étudie la façon dont les cellules recyclent leurs mitochondries en vue de développer une nouvelle approche qui préviendrait la métastase du cancer du poumon. 
Le cancer du poumon est le cancer le plus couramment diagnostiqué et celui associé au plus haut taux de mortalité au Canada. En effet, plus d’adultes au pays meurent des suites du cancer du poumon que des cancers du pancréas, du sein, du côlon ou du rectum réunis. La métastase, ou la propagation du cancer à d’autres parties du corps, est la principale cause de décès chez les patients atteints du cancer du poumon. Javad Alizadeh, boursier Vanier et candidat au doctorat à l’Université du Manitoba, est déterminé à trouver un moyen de prévenir le cancer du poumon métastatique. Jusqu’à présent, ses recherches ont montré qu’une protéine en particulier, située dans les mitochondries, semble jouer un rôle crucial dans la métastase des cellules cancéreuses du poumon et leur migration vers d’autres organes. Le chercheur espère que cette découverte contribuera à l’élaboration de nouvelles approches permettant de diminuer la métastase du cancer du poumon et de prolonger ainsi l’espérance de vie des patients atteints de ce cancer au Canada. Lectures complémentaires |
De la crise du virus H1N1 à la pandémie de COVID-19, ce réseau de collaboration en soins intensifs a tracé le chemin pour les essais cliniques en temps de crise sanitaire
Le Dr John Marshall a pris conscience de l’importance des essais cliniques interpandémiques après avoir vu échouer les lancements d’essais cliniques sur le virus H1N1 pendant la crise de 2009. En 2016, il a lancé l’essai Randomized Embedded Multifactorial Adaptive Platform trial in Community-Acquired Pneumonia (REMAP-CAP) afin de répondre au besoin d’essais cliniques proactifs – plutôt que réactifs – pour la préparation en cas de pandémie. Lorsque la pandémie de COVID-19 a été déclarée, le Dr Marshall a réorienté son essai multinational sur l’évaluation de traitements contre la forme grave de la COVID-19. Le Dr Marshall est un défenseur de longue date de la recherche clinique menée en collaboration par plusieurs instituts. Il a été président du Groupe canadien de recherche en soins intensifs de 2005 à 2012, une expérience qui a accru sa confiance en la recherche collaborative. En 2008, des réseaux d’essais cliniques similaires de partout dans le monde ont formé une alliance libre, l’International Forum for Acute Care Trialists (InFACT). Ces réseaux ont joué un rôle crucial dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, comme précédemment contre l’épidémie de H1N1. L’essai REMAP-CAP est une plateforme mondiale de recherche concertée. À ce jour, plus de 10 000 patients atteints de la COVID-19 ont été recrutés et l’essai a permis de démontrer les bienfaits des corticostéroïdes, des antagonistes des récepteurs IL-6 et des antiagrégants plaquettaires ainsi que les dangers de l’hydroxychloroquine. Les résultats ont d’ailleurs été pris en compte dans les lignes directrices de l’OMS et ont permis de changer la prise en charge clinique de la forme grave de la COVID-19. Le financement de l’essai REMAP-CAP a été renouvelé par le Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et d’urgence sanitaire des IRSC. Ces fonds représentent un soutien financier pour aller de l’avant, mais aussi un acte de reconnaissance envers l’équipe du Dr Marshall pour ses accomplissements dans le domaine de la préparation en cas de pandémie. Lectures complémentaires |
Faire avancer la médecine de précision dans le diabète de type 1 axée sur les cellules bêta par l’étude du sexe biologique et de la génétique 
Professeure agrégée au Département des sciences cellulaires et physiologiques de l’Université de la Colombie Britannique, la Dre Elizabeth Rideout est titulaire de la Chaire en science du sexe et du genre en génétique des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et a été nommée chercheuse¬-boursière de la Fondation Michael-Smith pour la recherche en santé en 2017. Le programme de recherche de la Dre Rideout vise à déterminer les gènes et les voies métaboliques qui contribuent aux différences entre les sexes au chapitre du métabolisme et des maladies métaboliques. Dans son laboratoire, la Dre Rideout se consacre notamment à l’étude des différences entre les sexes liées à la production d’insuline dans des conditions normales et stressantes, à l’aide de mouches, de rongeurs et de modèles humains. La Dre Rideout est la chercheuse principale désignée d’un projet financé par la subvention d’équipe des IRSC et de FRDJ « Médecine de précision dans le diabète de type 1 » (DT1). Son équipe de laboratoire utilise des îlots humains et des souris pour définir, en collaboration avec les laboratoires du Dr James Johnson, du Dr Bruce Verchere, du Dr Peter Thompson et du Dr Dan Luciani, l’incidence du sexe et de la génétique sur l’insuline à toutes les étapes de sa production et de sa libération dans le contexte de la pathogenèse du DT1. L’équipe évaluera la perturbation des mécanismes de synthèse, de traitement et de contrôle de la qualité chez les personnes de chaque sexe aux prises avec le DT1. L’équipe examinera également les effets de la modulation des principales étapes de la production de l’insuline sur la fonction des cellules bêta et la progression de la maladie dans le modèle murin par excellence du DT1. L’équipe pourra ainsi déterminer quelles étapes sont perturbées dans les cas de DT1 et si ces dérèglements permettent de cerner les personnes à haut risque de diabète. Les connaissances produites permettront d’évaluer si ces étapes peuvent être ciblées en vue de prévenir et de traiter le DT1. L’équipe appliquera à toutes les données une analyse comparative entre les sexes, et c’est pourquoi ses travaux représenteront une avancée importante dans l’élaboration de stratégies de prévention et de traitement fondées sur le sexe pour le DT1. Lectures complémentaires
|
Redonner le pouvoir à tous les jeunes atteints du diabète par la médecine de précision – projet EVERYONE 
Farid Mahmud est endocrinologue, professeur agrégé à l’Université de Toronto et chercheur associé à l’Institut de recherche de l’Hôpital pour enfants de Toronto. Ses travaux portent sur la recherche clinique sur le diabète, plus particulièrement sur l’évaluation précoce et la prévention des complications de la maladie et les répercussions des déterminants sociaux de la santé sur l’issue du diabète. Le Dr Mahmud est le chercheur principal de multiples essais cliniques, notamment AdDIT (Adolescent Type 1 Diabetes Cardio-Renal Intervention Trial) et l’essai clinique novateur ATTEMPT (Adolescent Type 1 diabetes treatment with SGLT2i for hyperglycemia & hyperfiltration trial), qui est financé dans le cadre de la Stratégie de recherche axée sur le patient des IRSC. Il est également l’un des rédacteurs des directives de consensus sur les pratiques cliniques de l’International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, publiées en 2022, qui fournissent des recommandations factuelles sur l’évaluation et le traitement des enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de diabète dans le monde entier. Le Dr Mahmud est le chercheur principal désigné du projet intitulé Redonner le pouvoir à tous les jeunes atteints du diabète par la médecine de précision – projet EVERYONE, qui a été financé par la subvention d’équipe des IRSC et de FRDJ « Médecine de précision dans le diabète de type 1 ». En plus de créer des connaissances sur la façon dont la diversité des facteurs génétiques, environnementaux et sociaux contribue aux différences dans la prise en charge du diabète de type 1, le projet a pour but de trouver des pistes d’amélioration aux résultats cliniques de tous les jeunes atteints du diabète de type 1. L’équipe de recherche suivra une approche personnalisée pour offrir des soins aux diabétiques à l’Hôpital pour enfants de Toronto et tirera parti d’autres pratiques régionales. Lectures complémentaires
|
La dynamique spatiotemporelle des lésions immunes et non immunes des îlots dans le contexte du diabète de type 1 
Le Dr Thompson est professeur adjoint au Département de physiologie et de physiopathologie de l’Université du Manitoba et chercheur principal à l’Institut de recherche de l’Hôpital pour enfants du Manitoba. Son programme de recherche, récemment établi, porte sur la compréhension du diabète de type 1 (DT1) sous l’angle des cellules bêta productrices d’insuline et leurs interactions complexes avec le système immunitaire. Par ses travaux, le Dr Thompson poursuit l’objectif à long terme de mettre au point de nouveaux traitements qui protégeront les cellules bêta de manière à prévenir et à guérir le DT1. Le Dr Thompson est le chercheur principal désigné d’un projet financé par la subvention d’équipe des IRSC et de FRDJ « Médecine de précision dans le diabète de type 1 ». Les membres de son équipe, notamment le Dr Guy Rutter de l’Université de Montréal, le Dr Herbert Gaisano de l’Université de Toronto, le Dr Pere Santamaria de l’Université de Calgary ainsi que des patients partenaires d’Action diabète Canada, se pencheront sur une théorie fascinante en vue d’expliquer pourquoi et comment le DT1 varie autant d’une personne à l’autre. L’équipe définira l’évolution du processus auto immun et évaluera s’il présente la capacité d’isoler et de détruire des populations de cellules bêta précises qui agissent à titre de régulatrices principales du débit d’insuline. Pour ce faire, l’équipe se servira d’une variété d’outils génétiques de pointe et l’imagerie prospective sur des modèles murins et des échantillons de pancréas humains qui ont développé le DT1 afin d’étudier l’hétérogénéité du processus auto-immun et ses effets sur les cellules bêta en temps réel. Réciproquement, l’équipe examinera les effets des mécanismes de stress ciblant les cellules bêta sur l’évolution de l’auto-immunité dans le contexte du DT1. Par la combinaison de ces études, l’équipe de recherche prévoit soutenir la mise au point de nouveaux traitements guidés par la médecine de précision contre le DT1. Lectures complémentaires
|
Décliner, refuser, résister?La perception de la démence par le corps infirmer et la prestation de soins d’hygiène personnelle non désirés dans les établissements de soins actifs 
Pour la plupart d’entre nous, qui tirons profit des privilèges inhérents à notre statut social, sommes valides et ne présentons aucun trouble du neurodéveloppement, le bain est synonyme de détente et de soins du corps dans une ambiance tamisée (et parfois de ponçage rigoureux des callosités!). Ce moment qui allie plaisir et hygiène n’est néanmoins pas perçu comme tel par l’intégralité de la population. Les médecins et les scientifiques ont en effet depuis longtemps établi que la toilette est un passage obligé du quotidien redouté par les personnes atteintes de démence. Les difficultés qu’elles rencontrent sur le plan cognitif, moteur et sensoriel contribuent à la propension de certaines d’entre elles à négliger leur hygiène personnelle à mesure que la maladie progresse et que les symptômes comportementaux et psychologiques les plus manifestes de la démence prennent le dessus. En qualité d’infirmière autorisée, Patricia Morris a conscience de l’ampleur du défi que représente l’assistance à des personnes qui refusent les soins d’hygiène personnelle offerts dans les établissements résidentiels spécialisés. Boursière Vanier et candidate au doctorat à l’Université du Nouveau-Brunswick, Patricia étudie les processus décisionnels sur lesquels s’appuie le personnel infirmier lorsqu’une personne résidente est souillée ou que ses vêtements ou son environnement immédiat doivent être lavés, mais qu’elle refuse l’aide proposée. Dans le cadre de séances de discussions dynamiques intégrant des exercices de simulation par immersion virtuelle, Patricia examine les descriptions qu’offre le personnel infirmier des personnes résidentes et de leur refus des soins. Elle s’intéresse tout particulièrement aux approches suivies par le personnel de soins actifs pour accomplir la tâche complexe de fournir des soins d’hygiène personnelle (ou de répondre au refus de certaines personnes résidentes) dans un contexte de pandémie mondiale qui impose d’accorder une priorité absolue à l’hygiène et à la prévention des infections à des fins de protection de la santé. Lectures complémentaires |
Venir à bout des formes les plus agressives du cancer de l’ovaire de façon naturelleRediriger les cellules tueuses naturelles du système immunitaire pour lutter contre les carcinomes séreux de haut grade 
Un diagnostic de cancer de l’ovaire ne devrait pas impliquer une lutte sans fin contre les effets secondaires des traitements suivis, pas plus qu’il ne devrait être interprété comme une condamnation à mort. Pourtant, dans le cas des carcinomes séreux de haut grade (CSHG), les chances de survie sont minces. Boursière Vanier, candidate au doctorat et communicatrice scientifique à l’Université Dalhousie, Sarah Nersesian œuvre à la mise au point de nouveaux traitements dans l’espoir de vaincre les CSHG et de remédier aux effets secondaires délétères des protocoles de soins actuels. Parmi les traitements qui commencent à voir le jour, les immunothérapies, qui consistent à renforcer la réponse du système immunitaire face au cancer, s’annoncent particulièrement prometteuses et présentent l’avantage de comporter des effets secondaires sensiblement plus endurables que les chimiothérapies conventionnelles. L’intégration de cellules tueuses naturelles (également appelées cellules NK) nourrit à cet égard beaucoup d’espoir, car elles s’attaquent efficacement aux cellules cancéreuses, bien que ces dernières résistent et parviennent à les désactiver. Afin de doter les cellules tueuses naturelles de capacités carcinolytiques renforcées, Sarah étudie, avec l’équipe du laboratoire de la Dre Jeanette Boudreau, leurs liens avec les CSHG. L’équipe a déjà découvert que certaines cellules tueuses naturelles possèdent une faculté accrue de prédire les effets des CSHG chez les patientes touchées. Elle espère que les résultats des travaux orienteront les efforts de développement de nouvelles immunothérapies et se traduiront par la création de nouveaux traitements au Canada. Lectures complémentaires
|
Les relations sexuelles sous l’emprise de substances psychoactives chez les hommes homosexuels séropositifs au VIHExplorer les effets de la séropositivité au VIH, de la santé mentale et de la consommation de substances psychoactives sur les pratiques sexuelles à risque 
Boursière Vanier et candidate au doctorat à l’École des sciences infirmières de l’Université d’Ottawa, Lauren Orser s’intéresse aux hommes gais, bisexuels, et plus généralement aux hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) qui consomment des substances psychoactives de synthèse (comme la méthamphétamine en cristaux) dans le cadre de rapports sexuels, une pratique connue sous le nom de chemsex. L’objectif de ses travaux est de cerner les facteurs qui influent sur la pratique du chemsex et de mettre en évidence ses effets sur la santé physique, le bien-être mental et les pratiques à risque de ces hommes. Pour mener à bien son projet, Lauren examine l’entrecroisement de facteurs tels que le stress associé à la séropositivité au VIH, la santé mentale, la consommation de substances psychoactives et la dépendance à ces substances. Les résultats des travaux permettront d’étendre les connaissances actuelles sur le chemsex et aideront le milieu de la recherche et le corps médical à apporter des solutions aux effets complexes et multiples de cette pratique sur la santé. Lectures complémentaires |
Déterminer les besoins et les priorités des femmes vivant avec le VIH en matière de santé reproductiveUne étude canadienne aux retombées mondiales 
L’espérance et la qualité de vie des personnes séropositives au VIH ont beaucoup augmenté comparativement au début de l’épidémie. Cette évolution a induit un changement de paradigme en ce qui a trait à la santé génésique des personnes infectées, tout particulièrement chez les femmes, qui représentent près du quart de la population vivant avec le VIH au Canada et près de la moitié sur l’ensemble de la planète. Boursière Vanier et candidate au doctorat en médecine à l’Université McGill, Lashanda Skerritt est membre de l’équipe de recherche qui pilote l’Étude sur la santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec le VIH au Canada (CHIWOS). Au cours de leurs consultations auprès des populations aux prises avec le VIH, Lashanda et son équipe ont constaté que les aspirations des Canadiennes séropositives sur la question de la santé génésique sont diverses et variées, mais que seul un tiers d’entre elles se sentent suffisamment à l’aise pour aborder le sujet avec leur médecin. Au moyen d’une carte heuristique, Lashanda a déterminé les priorités de santé d’un échantillon de femmes vivant avec le VIH au Canada. L’exercice révèle que sur le plan des soins reçus, le niveau de satisfaction de ces femmes est étroitement lié à leur sentiment de sécurité et au soutien dont elles bénéficient, ce qui suggère que la mise en place de conditions propices à la discussion de leurs aspirations en matière de santé génésique pourrait permettre de leur offrir des soins alignés sur leurs objectifs et leurs priorités. Lectures complémentaires |
Nouvelle thérapie génique pour améliorer les résultats cliniques des patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique
La thérapie cellulaire par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) est un traitement dans lequel les cellules T – un type de cellules du système immunitaire – sont isolées et modifiées pour être en mesure de reconnaître et d’attaquer les cellules cancéreuses. Ce traitement révolutionnaire est préparé en laboratoire et administré aux patients par infusion. Une des thérapies CAR-T actuellement disponible cible la protéine CD19 à la surface des cellules bêta cancéreuses. Les thérapies cellulaires par CAR-T donnent des résultats prometteurs dans le traitement de certaines formes de leucémie et de lymphome. Malgré tout, l’infusion de CAR-T ne permet de guérir que 30 à 50 % des cas de leucémie aiguë lymphoblastique ou d’en provoquer la rémission durable. Le Dr Kevin Hay croit que pour améliorer les résultats cliniques de la thérapie CAR-T pour les autres patients, il faudrait modifier les lymphocytes T utilisés dans la thérapie CAR-T pour qu’ils ciblent une protéine appelée CD22. Le Dr Hay codirige les premières équipes de recherche canadiennes disposant de l’expertise et des capacités voulues pour tester, fabriquer et distribuer ici même au Canada des lymphocytes T ciblant la CD22 pour la thérapie CAR-T. Pour le moment, grâce à une collaboration de recherche avec des laboratoires de la Colombie-Britannique, l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa et le Centre de recherche en thérapeutique en santé humaine du Conseil national de recherches, le Dr Hay pourra entreprendre un essai clinique de phase 1 afin d’évaluer les bienfaits de cette nouvelle thérapie et d’en déterminer la dose sécuritaire pour le traitement des enfants et des adultes atteints de leucémie aiguë lymphoblastique, y compris ceux dont le cancer a récidivé après une thérapie CAR-T ayant ciblé la CD19. L’équipe analyse également des échantillons de tumeurs et de sang dans l’espoir de découvrir d’autres protéines pouvant accroître les bienfaits des thérapies CAR-T contre d’autres types de cancer. Les résultats de l’étude du Dr Hay prépareront le terrain à d’autres essais et serviront de référence pour l’approbation de la thérapie CAR-T ciblant la CD22 au Canada, ce qui pourrait permettre à un plus grand nombre de patients en oncologie de profiter de cette thérapie génique révolutionnaire. Lectures complémentaires
|
Saisir les occasions de prévenir la judiciarisation dans les parcours de soins en santé mentale
|
Transformation des traitements contre le diabète de type 1
|
Comment promouvoir la saine croissance des enfants?
|
Des solutions inspirées des citoyens pour la santé des populations
|
Contribuer à l’élimination de l’hépatite C
|
Le rôle du sommeil sur le vieillissement du cerveau
|
Améliorer les méthodes de sédation et accélérer le rétablissement des fonctions cognitives des enfants gravement malades
Si la sédation intraveineuse fait partie intégrante de traitements salvateurs prodigués aux nombreux enfants admis en unité de soins intensifs pédiatriques, par exemple dans le cadre d’une ventilation mécanique, elle est également à l’origine d’épisodes de delirium chez plus de la moitié d’entre eux. Cette perturbation du fonctionnement cérébral nuit à la concentration, à la mémoire et à la capacité d’attention des enfants qui en font l’expérience et peut avoir des conséquences dévastatrices, comme un séjour prolongé à l’hôpital, un risque de mortalité accru et des effets durables sur les fonctions cognitives. Le choc émotionnel qui frappe les familles qui rendent visite à un enfant qui connait un épisode de delirium peut être très difficile à absorber, en particulier lorsque l’enfant est trop agité pour interagir avec ses proches ou n’est pas en mesure de les reconnaître Dans le cadre d’un essai clinique pilote, la Dre Angela Jerath, de l’Institut de recherche Sunnybrook, explore et met au banc d’essai de nouvelles méthodes de sédation. Le projet, nommé Accélérer le rétablissement cérébral chez les enfants gravement malades sous sédation par agents anesthésiques volatils (ABOVE), vise à déterminer si la sédation par inhalation est sécuritaire et peut être généralisée. Contrairement à la sédation intraveineuse, les agents anesthésiques inhalés ne s’accumulent pas dans le corps et sont rapidement éliminés par les poumons, ce qui suggère qu’ils pourraient favoriser l’arrêt précoce de la ventilation mécanique et, par voie de conséquence, réduire le risque de delirium et accélérer le rétablissement du cerveau. Un autre avantage conféré par la sédation par inhalation est sa facilité d’accès, puisqu’elle est utilisée quotidiennement dans les salles d’opération en toute sécurité et est à la fois bon marché et très répandue. La Dre Jerath mène des travaux sur la sédation depuis de longues années, et les épreuves qu’endurent les enfants gravement malades et leurs familles l’ont convaincue de mettre sur pied le projet avec son équipe de recherche. Composée de spécialistes de premier ordre dans les domaines des soins neurologiques et de la pédiatrie, l’équipe exerce dans des unités de soins intensifs diverses au Canada et dispose de l’expertise et des ressources nécessaires pour suivre pendant une année des enfants qui ont été sous sédation par inhalation et étudier leur fonctionnement cérébral. Le projet nourrit les espoirs de l’équipe en la capacité de la sédation par inhalation à ouvrir de nouvelles perspectives pour le corps médical et les familles en offrant aux enfants une meilleure qualité de sommeil et en réduisant le risque de survenue d’effets secondaires sur les fonctions cognitives. Lectures complémentaires
|
Réévaluation du traitement actuel des complications hémorragiques en soins intensifs
L’ulcère d’estomac est une complication qui survient, bien que rarement, chez les patients gravement malades des unités de soins intensifs (USI) dont les fonctions vitales sont maintenues artificiellement, en particulier chez ceux qui ont besoin d’un appareil respiratoire. Pour prévenir les hémorragies gastro-intestinales causées par ce type d’ulcère, les médecins des USI administrent souvent du pantoprazole, médicament qui réduit la production d’acide dans l’estomac. Or, ce traitement est associé à un risque accru d’infection pulmonaire et intestinale. Aussi faut-il se poser la question suivante : les bienfaits du pantoprazole l’emportent-ils sur ses risques? Répondre à cette question est l’un des objectifs de la Dre Deborah Cook, professeure émérite de médecine, d’épidémiologie clinique et de biostatistique à l’Université McMaster, qui dirige le plus important essai du monde mené par une équipe canadienne auprès de patients d’USI. L’essai REVISE (Re-Evaluating the Inhibition of Stress Erosions) vise à réévaluer cette pratique dans le traitement des patients gravement malades. Dans le cadre de cet essai, les chercheurs tentent entre autres de déterminer si la réduction de l’acidité gastrique par le pantoprazole réduit le risque d’hémorragie, si le pantoprazole fait plus de mal que de bien et si ce traitement vaut ce qu’il coûte. Depuis 1990, année où elle a cofondé le premier consortium national de recherche collaborative axé sur l’amélioration des résultats dans les USI, la Dre Cook a mené de nombreux essais pour fournir de l’information au personnel de ces unités et améliorer les soins quotidiens offerts aux patients les plus malades des hôpitaux au Canada et du monde. Ce qui motive la Dre Cook, c’est de satisfaire l’impératif éthique qui consiste à assurer la réévaluation continue des pratiques établies au fur et à mesure de l’évolution de l’épidémiologie des maladies graves et des interventions en soins intensifs. Lectures complémentaires |
Un type de cancer sous-étudié suscite l’intérêt par sa capacité à traiter les tumeurs qui se sont propagées à d’autres parties du corps
Le cancer œsogastrique est un type de cancer qui, malgré les progrès récents en la matière, n'a pas souvent été l'objet de recherches et ne propose pas beaucoup de traitements. Une option s'adresse aux patients qui présentent un statut HER2 positif, ou récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain. Avec cet essai, les personnes atteintes d'un cancer œsogastrique HER2 positif ont accès à un traitement de deuxième intention novateur qui cible la protéine HER2 exprimant le cancer. L'étude faisant l'essai d'un tel traitement est menée par la Dre Elena Elimova, oncologue spécialisée en gastro-entérologie au Centre de cancérologie Princess Margaret de Toronto. La Dre Elimova et son équipe appuient leurs recherches sur une étude prouvant l'efficacité du Zanidatamab, un anticorps qui cible la protéine HER2, et espèrent pouvoir améliorer les soins aux patients atteints d'un cancer œsogastrique et d'une maladie HER2 positive au Canada. Cette protéine est responsable de la croissance rapide des cellules cancéreuses partout dans le corps. Ainsi, l'étude de la Dre Elimova sur l'anticorps Zanidatamab a l'objectif d'arrêter ou de ralentir la croissance des tumeurs. Cette étude pourra accueillir un grand nombre de patients, puisqu'elle sera réalisée en collaboration avec le Groupe canadien des essais sur le cancer, le plus grand réseau de recherche sur le cancer au pays. Le retard accusé par la recherche sur le cancer œsogastrique rend ce dernier particulièrement fatal, et ce, même s'il est diagnostiqué rapidement. Par ses recherches, la Dre Elimova souhaite transformer la vie des patients atteints de ce type de cancer partout dans le monde. Lectures complémentaires |
Réduire la résistance aux antibiotiques par la transformation des politiquesPrévenir la propagation de superbactéries qui affectent l’agriculture, la santé et l’environnement 
L’utilisation inappropriée des antibiotiques accroît le taux de prévalence des superbactéries et met en évidence le besoin urgent de réfléchir à des changements structurels dans le secteur agricole et plus généralement dans les pratiques médicales à l’égard des êtres humains et des animaux. Dans le cadre de l’initiative Global 1 Health Network, la Dre Wiktorowicz et son équipe étudient le recours aux antibiotiques dans des pays à revenu faible, intermédiaire et élevé dans l’optique d’impulser la mise en place de mesures réglementaires qui amélioreront les pratiques agricoles, environnementales, de santé publique et de production de médicaments. Pour mener à bien son projet, la Dre Wiktorowicz examine les choix politiques et les stratégies de gouvernance qui font leurs preuves face à l’utilisation inappropriée des antibiotiques dans cinq pays (Sénégal, Philippines, Hongrie, Pays-Bas et Canada). Elle s’intéresse tout particulièrement à la gestion des conséquences de ces politiques sur le commerce de produits agroalimentaires et la santé humaine par les différents gouvernements et aux compromis consentis. Les conclusions de ses travaux aideront les décideurs et les parties prenantes à mettre au point des solutions intersectorielles. Lectures complémentaires
|
Améliorer les soins prodigués aux jeunes vivant avec une amyotrophie spinale par le jeu
Il ne fait aujourd'hui plus aucun doute que l'activité physique contribue à l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des enfants. Cela vaut tout particulièrement pour les jeunes qui présentent une amyotrophie spinale, une maladie génétique rare qui se manifeste par une faiblesse musculaire de gravité variable. Si de nouveaux traitements médicamenteux aident les personnes touchées à préserver leurs muscles et à vivre plus longtemps, les jeunes aux prises avec la maladie n'ont pas tous accès à des soins de qualité et ne trouvent pas toujours la motivation suffisante pour pratiquer une activité physique et étirer leurs muscles régulièrement. La transformation de traitements existants en activités récréatives pourrait-elle changer la donne? La Dre Maryam Oskoui, qui travaille au contact des jeunes vivant avec une amyotrophie spinale, de leurs familles et des prestataires de soins de santé, s'est aperçue que la clé de la mise sur pied de programmes de réadaptation physique stimulants réside dans l'intégration du jeu. Avec leur contribution, elle a développé un « exergame », un type de jeu vidéo spécifiquement conçu pour encourager les personnes qui l'utilisent à rester actives à domicile. Pour mesurer les progrès réalisés, le jeu s'appuie sur un capteur bon marché qui suit les mouvements du corps. Accompagnée de son équipe de recherche, la Dre Oskoui évalue actuellement l'efficacité de l'exergame créé sur la réadaptation des enfants et des jeunes qui vivent avec une amyotrophie spinale et espère parvenir à développer de nouvelles méthodes de mesure des bienfaits produits par les traitements de réadaptation sur leur quotidien. Les résultats de ses travaux faciliteront la mise en place de traitements adaptés aux besoins individuels de ces jeunes et favoriseront leur indépendance. La Dre Oskoui est membre d'INFORM RARE, un réseau de recherche canadien qui évalue les traitements destinés aux enfants vivant avec des maladies génétiques rares, mais soignables, et émet des recommandations pour améliorer les soins prodigués. Lectures complémentaires |
Les inconnues de l’utilisation des antibiotiques nuisent aux patientsLe programme de recherche BALANCE du Dr Daneman vise à enrichir la base de données probantes en la matière 
Les infections du sang sont l’une des principales causes de décès au Canada, mais des questions subsistent quant à la précision des traitements antibiotiques. D’ailleurs, malgré l’utilité de ces traitements, le recours excessif aux antibiotiques risque de donner lieu à une résistance aux antimicrobiens, un danger de taille à l’intérieur comme à l’extérieur des hôpitaux. C’est dans cette optique que le Dr Nick Daneman tente de parvenir à un équilibre entre la guérison des infections et la réduction des méfaits des antibiotiques. Dans le cadre de son essai BALANCE (Bacteremia Antibiotic Length Actually Needed for Clinical Effectiveness), il compare l’efficacité et les effets secondaires d’un traitement antibiotique de sept jours par rapport à quatorze jours dans le cas d’une infection du sang. Si un traitement de courte durée s’avère efficace, le monde entier pourrait réduire sensiblement son utilisation non essentielle d’antibiotiques. Or, une fois l’essai BALANCE achevé, de nombreuses questions resteront en suspens. L’essai BALANCE+, qui vient d’obtenir un financement, s’inscrira dans le prolongement de BALANCE et fournira des données probantes sur d’autres aspects des plans de traitement antibiotique, notamment pour déterminer s’il convient ou non de passer d’antibiotiques à large spectre à des médicaments à spectre plus étroit, si l’administration d’antibiotiques par voie orale est aussi efficace que par intraveineuse, quels antibiotiques oraux choisir et comment traiter les infections causées par les cathéters intraveineux. BALANCE est le plus important essai jamais réalisé sur des patients atteints d’une infection du sang, et l’étude compte déjà 3 400 participants répartis dans 73 hôpitaux, nombre non négligeable de patients qui bénéficieront de meilleurs soins tout en contribuant, espérons-le, à la réduction générale du risque de résistance aux antimicrobiens. Lectures complémentaires |
Une substance viscéraleLien entre les lésions de la substance blanche du cerveau et la déficience cognitive dans les cas de maladie neurodégénérative 
La substance blanche est un tissu cérébral qui relie diverses régions du cerveau pour permettre la communication. Sa détérioration par une maladie neurodégénérative peut conduire à la déficience cognitive. Dana Broberg est étudiante au doctorat à l’Université Western. Ses recherches visent principalement à comprendre comment des lésions de la substance blanche observées grâce à l’imagerie structurelle se comparent à de potentielles lésions de la substance blanche d’apparence normale en stade précoce. Dana espère pouvoir déterminer s’il existe un lien entre les lésions de la substance blanche en stade précoce, détectées par imagerie de diffusion, et la déficience cognitive résultant de maladies neurodégénératives. Elle désire également valider un nouveau biomarqueur vocal des troubles cognitifs que les cliniciens peuvent utiliser à la fois pour interpréter et détecter précocement la déficience cognitive. Dana est lauréate du Prix d’excellence Anne Martin-Matthews en recherche sur le vieillissement 2022 de l’Institut du vieillissement des IRSC. Elle mène ses recherches dans le cadre de l’Ontario Neurodegenerative Disease Research Initiative (ONDRI), qui vise à caractériser cinq maladies évoluant vers la démence : maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, démence frontotemporale, sclérose latérale amyotrophique et maladie cérébrovasculaire. Lecture connexe |
Améliorer les soins destinés aux patients les plus gravement malades dans le monde entier
Le Dr Srinivas Murthy est professeur-clinicien agrégé au Département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique. Améliorer l’état des patients est l’objectif premier de ses recherches sur les infections émergentes et les épidémies, dont les débuts précèdent la pandémie de COVID-19. En effet, en réaction à la pandémie de H1N1 en 2009, son équipe a conçu une plateforme d’essais cliniques qui s’est avérée l’une des plateformes les plus importantes pendant la pandémie de COVID-19. L’équipe du Dr Murthy utilise actuellement l’essai clinique REMAP-CAP (en anglais seulement) pour étudier des façons d’améliorer les soins aux patients hospitalisés des suites de l’influenza. Cette maladie respiratoire courante, qui touche des millions de personnes au Canada chaque année, est l’une des principales causes des pneumonies nécessitant une hospitalisation. L’essai clinique du Dr Murthy vise à trouver la combinaison optimale de traitements – antiviraux, stéroïdes et immunomodulateurs – qui permettra aux patients d’obtenir leur congé plus rapidement. L’équipe souhaite également déterminer la meilleure approche axée sur le patient pour obtenir le consentement des participants dans le contexte d’un essai clinique. Lectures complémentaires |
Dépistage rapide, peu coûteux et efficace des superbactériesDe nouveaux marqueurs génétiques de la résistance aux antimicrobiens devraient aider les chercheuses et chercheurs à détecter et à traiter rapidement les infections bactériennes 
Le Dr Dylan Pillai dirige un groupe multinational de scientifiques qui tentent d'éliminer les « superbactéries » au moyen d'interventions pratiques visant à réduire la prévalence des infections résistantes aux antibiotiques chez les humains et les animaux vivant à proximité du lac Laguna de Bay, aux Philippines. À cette fin, son équipe déploiera d'abord une approche multifacettes de surveillance et de détection de la résistance aux antibiotiques dans les hôpitaux. Grâce à un programme de gestion des antibiotiques accessible par une application, les médecins des Philippines auront accès aux Lignes directrices nationales sur l'usage d'antibiotiques et à un test de dépistage rapide par amplification des acides nucléiques et au point d'intervention pour détecter les infections résistantes aux antibiotiques d'origine communautaire chez les patients des urgences et des unités de soins intensifs. Le groupe du Dr Pillai effectuera également une surveillance des organismes hautement résistants aux antibiotiques pour réduire la surutilisation des antibiotiques. Le test au point d'intervention servira aussi à mettre au point des tests de dépistage rapides, abordables et portatifs capables de détecter de nombreux types de pathogènes (tels que le SRAS-CoV-2 ou le paludisme en Éthiopie et au Sri Lanka, des pays aux ressources limitées). Lectures complémentaires
|
Un nouvel essai clinique sur le déficit immunitaire contribuera à la thérapie par édition génomique au Canada
L’édition génique est une thérapie innovatrice au Canada. Nicola Wright, hématologue à l’Université de Calgary, se place à l’avant-garde dans ce domaine grâce à un projet pilote visant à développer l’infrastructure et l’expertise requises pour appliquer cette thérapie au pays. Le laboratoire de la Dre Wright, en collaboration avec le Dr Donald Kohn de l’Université de la Californie à Los Angeles, a élaboré une stratégie d’édition de base visant à traiter le déficit immunitaire combiné sévère (DICS) affectant la chaîne CD3δ, une maladie génétique où les enfants naissent sans système immunitaire, ce qui rend mortelles presque toutes les maladies courantes. Grâce à un essai clinique multicentrique réalisé au Canada, l’étude a pour but de tester l’édition de base chez les patients atteints de cette forme de DICS. Pour ce faire, la Dre Wright et son équipe recueillent des cellules tirées de la moelle osseuse des patients, remplacent le nucléotide CD3δ défectueux par le bon nucléotide, puis réinsèrent les cellules dans l’organisme des patients, avec un suivi à long terme des résultats cliniques et de la reconstitution immunitaire. Une fois que le problème concernant l’ADN a été réglé, les patients peuvent produire leurs propres cellules T pour combattre les infections. Au Canada, ce genre de thérapie est rare, et les patients atteints de troubles immunitaires doivent généralement aller suivre un traitement dans d’autres pays, où la seule thérapie commercialisée peut coûter plus de 2 millions de dollars. Le projet de la Dre Wright devrait ouvrir la voie à des thérapies plus avancées pour d’autres maladies génétiques rares, ce qui permettra aux patients de se faire soigner plus près de chez eux. Il n’est pas facile de vivre avec un DICS, mais les recherches de la Dre Wright tracent une voie à suivre pour que les enfants immunodéprimés puissent mener une vie normale et en bonne santé. Si cet essai est le premier au Canada qui vise à traiter les maladies immunitaires par l’édition génique, il ne sera certainement pas le dernier. Lectures complémentaires |
De la cellule à la société : une approche équitable de la rechercheUne boursière Vanier de l’Université de la Colombie-Britannique s’appuie sur la communauté pour étudier l’incidence clinique et sociale du VIH sur les femmes 
La découverte de traitements efficaces contre le VIH offre une occasion unique de comprendre les effets de la maladie sur le vieillissement des femmes qui en sont atteintes. Shayda Swann, boursière Vanier, étudie l'action du virus sur leur santé génésique et leurs hormones, comme l'estrogène et la progestérone, et son rôle dans l'apparition de l'ostéoporose ou de troubles cardiaques ou hépatiques. Elle examine également l'incidence du contexte social sur la discrimination raciale et de genre, l'usage de substances psychotropes, la pauvreté et le stress auxquels sont confrontées les femmes porteuses de la maladie. L'objectif de Shayda Swann est de démontrer que la diffusion directe des résultats de recherche auprès des femmes qui vivent avec le VIH au moyen de vidéos sur YouTube, de rencontres scientifiques décontractées, de séances d'échange ou encore de l'application des connaissances sous forme artistique se traduira par de précieuses avancées grâce à un travail réalisé main dans la main avec les membres de la communauté. Shayda Swann est membre de l'équipe de recherche sur le vieillissement en santé des femmes du projet Collaboration de Colombie-Britannique Carma-Chiwos (BCC3). Composée de femmes vivant avec le VIH, de cliniciens, d'universitaires et de membres de la communauté de la Colombie-Britannique, l'équipe a pour objectif d'approfondir les connaissances sur le vieillissement en santé des femmes touchées par la maladie. Lectures complémentaires |
Des progrès dans le traitement par corticostéroïdes pourraient améliorer considérablement la santé des patients atteints d’insuffisance respiratoire
Bram Rochwerg, médecin aux soins intensifs et chercheur à Hamilton, s’occupe de patients gravement malades, dont un grand nombre est hospitalisé en raison d’une insuffisance respiratoire aiguë qui exige une aide à la respiration. L’insuffisance respiratoire peut être due non seulement à la COVID-19, mais aussi à une pneumonie, à une inflammation pulmonaire, à un sepsis ou à l’aspiration d’un corps étranger, entre autres causes. L’expérience acquise en première ligne par le Dr Rochwerg a servi de base à un nouvel essai, financé par le Fonds pour les essais cliniques, qui cherche à répondre à des questions pressantes concernant le rôle des corticostéroïdes — un anti-inflammatoire bien connu — chez les patients atteints d’insuffisance respiratoire aiguë. Baptisé CORT-E2, l’essai testera l’efficacité et l’innocuité du recours précoce aux corticostéroïdes chez les patients aux soins intensifs atteints d’insuffisance respiratoire non liée à la COVID-19, ainsi que de la prolongation de ce traitement chez les patients aux soins intensifs présentant une insuffisance respiratoire persistante, qu’elle soit liée ou non à la COVID-19. Bien sûr, les corticostéroïdes sont déjà couramment employés en médecine. L’essai prendra donc appui sur cette expertise pour mettre au point les détails du traitement. On cherchera par exemple à déterminer si les corticostéroïdes sont aussi bénéfiques chez les gens qui n’ont pas la COVID-19 que chez ceux qui en sont atteints, et quelle est la durée optimale du traitement, en particulier chez les personnes dont l’état ne s’améliore pas avec les soins de soutien habituels. Selon le Dr Rochwerg, si le traitement précoce ou prolongé s’avère bénéfique, son adoption sera simple puisqu’il s’agit d’une intervention à faible coût (les corticostéroïdes sont un médicament générique relativement peu coûteux) et facile à réaliser (on peut les administrer aisément par voie orale ou intraveineuse). Cette intervention améliorera directement la santé des quelque 30 000 personnes hospitalisées chaque année au Canada pour une insuffisance respiratoire, toutes causes confondues. L’essai CORT-E2 s’inscrit dans une vaste plateforme d’essais cliniques randomisés pour les maladies graves, d’initiative canadienne, appelée PRACTICAL. Ce genre de plateforme se veut une façon de maximiser l’efficience de la recherche en permettant d’étudier plusieurs interventions au sein de la même infrastructure d’essais cliniques. Par conséquent, le Dr Rochwerg et les équipes de CORT-E2 et de PRACTICAL collaborent avec un vaste éventail de chercheurs, de cliniciens, de patients et de partenaires pour améliorer de façon concrète la santé de patients gravement malades partout au Canada et dans le monde entier. Lectures complémentaires |
Notre propre microbiome peut-il aider à traiter et à prévenir la présence d’organismes résistants aux antimicrobiens?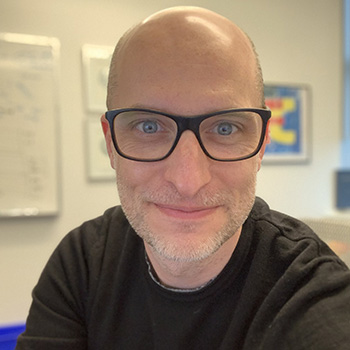
Selon un rapport de surveillance publié en 2022 par l’Agence de la santé publique, la résistance aux antimicrobiens est l’un des dix principaux problèmes de santé publique à l’échelle mondiale. La plupart des approches visant à traiter les infections reposent sur les antibiotiques. Cependant, nous constatons actuellement un déclin de l’efficacité des antibiotiques à mesure que des pathogènes résistants aux médicaments font leur apparition; par conséquent, nous devons élaborer et tester de nouveaux traitements pour lutter contre les organismes résistants aux antimicrobiens. Le Dr Bryan Coburn, clinicien-chercheur et spécialiste des maladies infectieuses au Réseau universitaire de santé, procède actuellement à l’élaboration de traitements novateurs de la résistance aux antimicrobiens qui font appel à des consortiums microbiens, ou plus simplement, à des mélanges de cultures bactériennes vivantes, dans le cadre d’un essai clinique intitulé Microbial Ecosystem Therapeutic-2 (MET-2). La Dre Ashley Rooney, boursière postdoctorale qui a soutenu sa thèse de doctorat sous la supervision du Dr Coburn en 2022, a émis l’hypothèse que les consortiums microbiens pourraient diminuer le nombre d’infections causées par des organismes résistants aux antimicrobiens. Pour mieux comprendre les avantages potentiels des consortiums microbiens, le Dr Coburn et son équipe travaillent à un essai clinique pilote appelé Décolonisation des organismes résistants aux antimicrobiens après une perturbation du microbiome. L’étude évaluera si un consortium de bactéries administré sous forme de comprimés peut aider à diminuer ou à éradiquer la présence d’organismes résistants aux antimicrobiens, à améliorer le microbiome des patients, et à servir de complément aux antibiotiques pour le traitement et la prévention des infections. Les chercheurs détermineront s’ils peuvent recruter des participants en toute sécurité pour cet essai. En outre, ils espèrent que leurs conclusions préliminaires mèneront à la tenue d’un essai clinique MET-2 à plus grande échelle dans l’avenir. Lectures complémentaires
|
Un remède futuriste contre le cancer du sang est à notre portée, et la Dre Kekre pense que le Canada devrait s’y intéresser
Natasha Kekre, hématologue à l’Hôpital d’Ottawa et professeure agrégée à l’Université d’Ottawa, se consacre à la conception d’un traitement novateur contre la leucémie. Après avoir vu plusieurs de ses patients succomber à leur cancer, et ce, malgré des traitements intensifs de chimiothérapie, la Dre Kekre se penche maintenant sur le traitement T-CAR, où les cellules immunitaires du patient sont génétiquement modifiées pour combattre la leucémie. Pour créer des cellules T-CAR, les cellules immunitaires du patient sont prélevées dans son sang, génétiquement modifiées et activées en laboratoire avant de lui être administrées, pour ainsi cibler directement le cancer. Cependant, l’expertise et les infrastructures nécessaires pour ce traitement personnalisé sont rares au Canada. La Dre Kekre pense que son essai clinique devrait fournir les renseignements nécessaires pour que Santé Canada approuve le traitement et que ce produit canadien devienne une norme de soin pour les patients canadiens atteints de cancer. La Dre Kekre et son équipe espèrent prouver que les cellules T-CAR, qui ciblent une protéine spécifique aux tumeurs appelée CD19, peuvent améliorer la durée de vie des patients souffrant de leucémie lymphoblastique. De plus, la Dre Kekre montrerait ainsi à Santé Canada que ces cellules modifiées peuvent être conçues au Canada. L’aspect le plus gratifiant de son travail est sans conteste l’espoir qu’elle apporte aux patients atteints de cancer. Les cellules T-CAR produites au Canada sont une lueur d’espoir contre une forme de cancer très agressive. Selon la Dre Kekre, l’essai clinique a pour but d’amener au Canada un nouveau traitement dont la population pourrait bénéficier. Si elle réussit à prouver que les cellules T-CAR sont efficaces et sûres, un nouveau traitement contre la leucémie sera accessible au Canada. Lectures complémentaires |
La médecine de précision ouvre la voie à une utilisation plus sûre de la ventilation mécanique pour les patients qui présentent une insuffisance respiratoire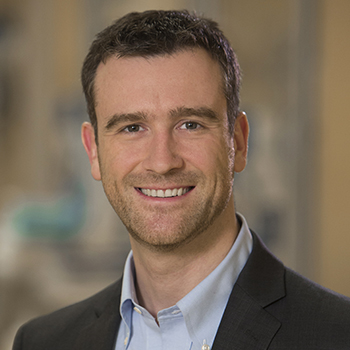
Lorsque des patients développent une détresse respiratoire et qu’ils ne peuvent plus respirer par eux-mêmes, un système de ventilation mécanique est utilisé pour suppléer les fonctions pulmonaires et maintenir les patients en vie. Cette intervention sauve des vies, mais occasionne parfois aussi une surdistension des poumons susceptible d’entraîner une défaillance organique, voire la mort. Pour remédier à cette situation, le Dr Ewan Goligher, du Réseau universitaire de santé, prévoit de mettre au banc d’essai une nouvelle stratégie de ventilation mécanique qu’il estime plus sûre et plus efficace et qui réduira les risques de lésion pulmonaire tout en assurant une bonne ventilation des poumons. Le projet vise à étudier les effets d’une ventilation mécanique programmée pour éviter les pressions d’insufflation fortes plutôt que les volumes élevés dans le but d’améliorer la prise en charge des patients. L’utilisation de volumes élevés semble en effet aggraver les lésions pulmonaires lorsque le niveau de pression dans les poumons est fort, mais ne produire aucun effet délétère si ce niveau reste faible. L’insuffisance respiratoire aiguë est associée à un taux de mortalité élevé (supérieur à 40 %). Si la ventilation mécanique apporte une réponse à un besoin vital pour les patients, elle n’est pas pour autant dénuée de risques de lésion pulmonaire. Les travaux du Dr Goligher pourraient selon lui donner naissance à des traitements plus précis favorisant l’adaptation des systèmes de ventilation aux besoins de chaque patient, ce qui représente un pas vers une approche personnalisée. La pandémie de COVID-19 a fait exploser le taux de prévalence de l’insuffisance respiratoire au sein de la population et suscité une multiplication des appels au changement. Si les espoirs du Dr Goligher se confirment, une procédure d’ores et déjà salvatrice deviendra à la fois plus précise et plus sûre. Lectures complémentaires |
Consortium pancanadien Accélérer la recherche par les essais cliniquesUn nouveau consortium pancanadien sur les essais cliniques promet de resserrer les liens entre les intervenants dans le domaine des essais cliniques et de soutenir les réseaux de recherche connexes du Canada 
Les essais cliniques rapides sont essentiels à la protection et à l’amélioration de la santé humaine. Au Canada, la réalisation d’essais cliniques est malheureusement parsemée d’obstacles, d’où la création d’un nouveau consortium. Le consortium Accélérer la recherche par les essais cliniques est un vaste réseau regroupant des chercheurs, des patients ainsi que des représentants du gouvernement et de l’industrie de partout au Canada. Dirigé par un comité des opérations composé de douze personnes et par deux coprésidents, le Dr P. J. Devereaux de l’Université McMaster et le Dr Guy Rouleau du Centre universitaire de santé McGill, le consortium a pour but de faciliter les essais cliniques nationaux, la participation canadienne aux essais internationaux et la mise en œuvre de leurs résultats à grande échelle. Le consortium constitue l’un des volets d’une initiative canadienne de plus grande envergure, la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie. Les essais cliniques, en particulier les essais contrôlés randomisés, jouent un rôle essentiel dans l’industrie des soins de santé et fournissent des preuves tangibles de l’efficacité des nouveaux médicaments et traitements. Or, il peut parfois s’avérer difficile de réaliser des essais cliniques et de tenir des discussions importantes entre les intervenants. C’est pourquoi le consortium vise à agrandir et à soutenir les équipes et les réseaux existants dans le domaine des essais cliniques ainsi qu’à créer de nouveaux réseaux dans des domaines prioritaires. Les visées du consortium ne s’arrêtent toutefois pas au réseautage : le consortium représente un grand virage dans la manière de réaliser des essais cliniques au Canada. L’équipe, composée de 250 personnes, prévoit améliorer les processus d’approbation nationaux en matière d’éthique, simplifier les contrats en matière d’essais contrôlés randomisés, créer des sources de données efficaces et explorer des modèles d’essais novateurs. À tous égards, le consortium devrait atteindre les résultats escomptés, soit de démocratiser les essais cliniques et de favoriser l’accès équitable, la participation et la mise en commun de l’information. Pour le Dr Devereaux, candidat principal désigné, le consortium représente la chance de collaborer avec des personnes de partout au Canada qui s’emploient avec ardeur à améliorer la santé par la promotion des essais cliniques au pays. Le consortium est coprésidé par le Dr P. J. Devereaux et le Dr Guy Rouleau, tandis que son comité des opérations est formé de membres provenant des quatre coins du pays, à savoir : le Dr Wayne Clark, le Dr Dean Fergusson, le Dr Amit Garg, le Dr Jeremy Grimshaw, la Dre Valerie Harvey, la Dre Corinne Hohl, la Dre Catherine Joyes, la Dre Susan Marlin, la Dre Emily McDonald, la Dre Louise Pilote, le Dr Stuart Nicholls et le Dr Lawrence Richer. Lectures complémentaires |
Contribuer à atteindre la souveraineté alimentaire des Inuits à Arviat, au Nunavut
L'incidence de l'insécurité alimentaire au Nunavut est la plus élevée au Canada, et elle est quatre fois plus élevée que la moyenne nationale. L'étude menée par Mme Shirley Tagalik, la Dre Gita Ljubicic et leur équipe de recherche de l'Université McMaster porte sur une exploitation communautaire coordonnée de l'oie comme éventuelle solution pour améliorer la souveraineté alimentaire à Arviat, au Nunavut. Mme Tagalik est la directrice de la Société Aqqiumavvik, un organisme qui s'emploie à résoudre l'insécurité alimentaire ainsi que d'autres enjeux communautaires à Arviat, au Nunavut. Elle est également partenaire de l'Environnement réseau pour la recherche sur la santé des Autochtones du Nunavut (ERRSA du Nunavut). Ses recherches portent sur l'éducation, le développement de l'enfant et du langage, la mobilisation des jeunes et la prévention du suicide, les déterminants de la santé, la guérison, la revitalisation culturelle, les changements climatiques et la sécurité alimentaire. Forte de plus de 30 ans de travail auprès d'aînés inuits, Mme Tagalik répertorie les connaissances culturelles inuites et elle cherche à rétablir les forces des concepts culturels dans les programmes communautaires. Elle a récemment reçu le Prix du gouverneur général pour l'innovation en reconnaissance de son travail de recherche intitulé « Corridors de l'Arctique et Voix du Nord ». La Dre Gita Ljubicic est professeure agrégée à l'École de la terre, de l'environnement et de la société de l'Université McMaster et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en recherche communautaire pour la durabilité du Nord. Ses travaux se situent à la croisée de la géographie culturelle et de la géographie environnementale, et découlent d'un profond engagement à respecter les connaissances autochtones et à en tirer des enseignements complémentaires à la science, afin de résoudre des enjeux socioécologiques complexes. Au cours des 20 dernières années, elle a collaboré avec des organismes et des membres de la communauté inuite des quatre coins de l'Inuit Nunangat (territoire inuit canadien) à des projets visant à répondre aux priorités ciblées par la communauté. Mmes Tagalik et Ljubicic et leur équipe ont pour objectif ultime d'améliorer les pratiques de recherche, de contribuer à la prise de décisions et de soutenir l'autodétermination des Inuits en matière de recherche. Lectures complémentaires
|
Le savoir inuit pour favoriser l’adaptation aux changements climatiques
Sherilee Harper, M. Sc., Ph. D., est titulaire d'une Chaire de recherche du Canada sur les changements climatiques et la santé et professeure agrégée à l'École de santé publique de l'Université de l'Alberta. Ses recherches portent sur les conditions météorologiques, l'environnement et la santé dans le contexte du changement climatique au Canada, en Ouganda et au Pérou. La Dre Harper collabore avec des représentants gouvernementaux et communautaires afin de favoriser l'application de mesures sanitaires, la planification, le déploiement d'interventions et la recherche en lien avec le climat. Elle est coautrice principale du Rapport spécial sur l'océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ainsi que du sixième rapport d'évaluation du GIEC, en plus de siéger au groupe de travail sur le genre du GIEC et au comité éditorial de la revue Epidemiology and Infection. La Dre Harper est chercheuse principale au sein du programme Niqivut Silalu Asijjipalliajuq (« Notre alimentation et les changements climatiques »). Ce programme de recherche vise à accroître la faculté d'adaptation des Inuits en renforçant leur capacité à détecter les effets du climat sur la santé dans le contexte de l'alimentation et y répondre, et à évaluer les politiques, les programmes et les mesures pouvant être mis en place pour adapter l'alimentation aux changements climatiques. Le programme comporte deux axes de recherche : 1) renforcer la souveraineté alimentaire des communautés inuites dans une optique d'adaptation aux changements climatiques, et 2) transmettre le savoir inuit pour renforcer l'adaptation aux changements climatiques. Il abordera également les thèmes importants que sont les connaissances inuites liées à la recherche, à la santé, à la nutrition, au bien-être, à l'adaptation aux changements climatiques et au genre. Les retombées de cette approche de recherche dirigée par les Nunavummiut seront multiples : établissement de pratiques exemplaires pour d'autres initiatives, formation de chefs de file dans les domaines des changements climatiques, de l'alimentation traditionnelle et de la santé des Inuits, et mise en valeur des connaissances inuites et de l'Inuit Qaujimajatuqangit pour permettre aux communautés de s'adapter aux effets du climat sur la santé dans le contexte de l'alimentation. Lectures complémentaires
|
Renforcer la sécurité alimentaire dans les Territoires du Nord-Ouest
Kelly Skinner est professeure agrégée à l'École de santé publique de l'Université de Waterloo. En 2022, les Instituts de recherche en santé du Canada et l'Agence de la santé publique du Canada ont attribué à la Dre Skinner la chaire de recherche appliquée en santé publique « Environnements sains pour lutter contre les changements climatiques et l'insécurité alimentaire dans le Nord canadien ». Cette chaire vise à mieux comprendre les liens entre la sécurité alimentaire, les changements climatiques et les communautés autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), les régions nordiques du Canada et le Nord circumpolaire, à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur l'action communautaire, l'autodétermination et la mise en commun des connaissances. Dans le cadre de ses travaux, la Dre Skinner collabore avec des communautés, des partenaires et des gouvernements du Nord à des projets sanitaires et sociaux interdisciplinaires, communautaires et collaboratifs portant sur l'alimentation, la nutrition, la sécurité alimentaire, la communication en santé et la communication des risques, ainsi que sur le contexte plus vaste des systèmes et des environnements alimentaires nordiques et autochtones. Ces travaux ont comporté une évaluation des programmes et de l'alimentation des jeunes, ainsi que des démarches de développement communautaire; ils ont progressé vers la justice sociale et les politiques sociales visant à améliorer la sécurité alimentaire et à promouvoir la souveraineté alimentaire. La Dre Skinner est la chercheuse principale désignée d'un projet qui vise à apprendre des communautés et à améliorer leur capacité de s'attaquer à des priorités adaptées aux milieux, afin d'éclairer les interventions locales, régionales et territoriales en matière de changements climatiques et de sécurité alimentaire. Cette approche aborde les thèmes transversaux que sont le savoir traditionnel, la gouvernance, les jeunes, ainsi que le sexe et le genre, et elle repose sur la recherche-action participative. Son équipe multidisciplinaire collabore étroitement avec des partenaires dans six communautés situées dans quatre régions des T.N.-O. pour comprendre le potentiel des interventions locales, ainsi que pour diversifier et amplifier l'apprentissage. Ces travaux de recherche encouragent les interventions communautaires et l'autodétermination des systèmes alimentaires locaux dans les communautés des T.N.-O. et, en définitive, améliorent les résultats sur le plan de la santé. Les connaissances acquises, et communiquées à plusieurs niveaux (local, régional, territorial, et parmi les décideurs et les utilisateurs de connaissances au sein des gouvernements) faciliteront l'élaboration de programmes et de politiques plus efficaces contre l'insécurité alimentaire et les changements climatiques dans les T.N.-O. Lectures complémentaires
|
- Date de modification :






