Découvertes pour la vie
Les visages de la recherche en santé 2022
| Titre |
|---|
Explorer l'arthrose sous l'angle de la composante osseuseL'arthrose peut se détecter d'abord par des altérations osseuses 
L'arthrose est la maladie articulaire chronique la plus courante. Précipitée par des lésions articulaires, elle peut se manifester tout au long de la vie, entraînant des douleurs importantes et une perte de fonction. Or, la capacité de détecter tôt les altérations articulaires liées à l'arthrose demeure un problème, les options de traitement s'en trouvent donc limitées avant que les altérations ne deviennent permanentes. De récentes recherches ont révélé que l'arthrose n'est pas simplement une maladie articulaire caractérisée par une usure du cartilage, mais par une incapacité de l'organisme à réparer les tissus endommagés. Tous les tissus articulaires sont interdépendants, et des recherches ont récemment permis de montrer que des altérations des os, ou à l'intérieur de ceux-ci, peuvent se manifester avant que des dommages aux autres tissus articulaires puissent être détectés. Dans le cadre de sa recherche réalisée grâce à une bourse postdoctorale Banting des IRSC, le Dr Nikolas Knowles a exploré, au moyen de l'imagerie multimodale, les altérations osseuses consécutives à une blessure aiguë au ligament croisé antérieur du genou, dans une cohorte longitudinale. Cette imagerie à haute résolution a révélé des changements irréversibles de la microstructure osseuse dans les quatre années suivant la blessure, ainsi que d'importants changements dans les tissus de la moelle osseuse. Aujourd'hui professeur adjoint au Département de kinésiologie et des sciences de la santé de l'Université de Waterloo, le Dr Knowles s'appuie sur ces résultats pour tenter de concevoir un cadre d'imagerie informatique expérimental et mieux comprendre les voies mécanistiques du déclenchement, de la progression et du traitement de l'arthrose. Lectures connexes :
|
Transformer les essais pour qu’ils aient un impact mondialUn néphrologue conçoit des solutions prometteuses grâce à des partenariats novateurs 
Les travaux du Dr Garg cherchent à améliorer les résultats des patients atteints de maladies du rein en examinant leurs cas, de leur diagnostic précoce à leur traitement. Pour ce faire, le docteur a imaginé des approches rationalisées et novatrices en matière d’essais cliniques et examiné les ressources en mégadonnées. Il s’est récemment employé à améliorer l’évaluation des donneurs de rein vivants et dirigé MyTemp, grand essai pragmatique visant à déterminer si les changements de température du dialysat peuvent réduire le nombre d’admissions à l’hôpital ou de décès en raison de problèmes cardiovasculaires. Le Dr Garg continue de réaliser ses propres travaux en néphrologie et d’enseigner des méthodes d’essai novatrices à de nouveaux chercheurs. Il a aussi collaboré avec une équipe d’intervenants pour créer la plateforme d’accélération des essais randomisés (Accelerating Randomized Trials [ART] Platform) afin d’aider les chercheurs à effectuer des grands essais pragmatiques efficaces qui priorisent des interventions simples, adaptables et durables. Lectures connexes :
Publications récentes :
|


Programme du projet « SUGARNSALT » (SodiUm Glucose co-trAnspoRt-2 inhibitioN diabeteS and kidney function loss in Type 1 diabetes)Dr David Cherney Le Dr David Cherney est professeur de médecine et clinicien-chercheur à la Division de néphrologie de l’Université de Toronto. Il est également médecin au Réseau universitaire de santé et à l’Hôpital Mount Sinai, où il est directeur du laboratoire de physiologie rénale. Comme il s’intéresse tout particulièrement à la relation entre le diabète et les maladies du rein et du cœur, le Dr Cherney mène des recherches sur les facteurs physiologiques qui provoquent des néphropathies chez les patients diabétiques. Il a dirigé plusieurs essais cliniques de grande envergure qui ont examiné les différentes causes des néphropathies, en particulier le diabète. Le Dr Cherney est le chercheur principal désigné d’un projet financé par une subvention d’équipe des IRSC Mécanismes du diabète et solutions translationnelles. Dans ce programme de recherche, son équipe et lui examinent les effets de l’inhibition du SGLT2 sur les reins de personnes atteintes de diabète de type 1 pendant un traitement de deux ans, ce qui inclut des tests sanguins et urinaires. Ils tentent de comprendre comment ces médicaments fonctionnent à long terme, comment éviter les effets secondaires, et comment réagissent les patients à la prise des médicaments, en surveillant tant les bienfaits que les effets secondaires. Ils comptent ensuite utiliser les dossiers de santé de patients danois (puisque le Danemark est un pays où les inhibiteurs du SGLT2 peuvent être utilisés pour traiter le diabète de type 1) en vue de déterminer si ces médicaments réduisent les risques de néphropathie lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre des traitements réguliers pour le diabète de type 1. Enfin, le chercheur et son équipe étudieront l’efficacité de ces médicaments pour protéger les reins à long terme à l’aide de modèles mathématiques. Globalement, ce programme a le potentiel de réduire les risques de complication associés au diabète et d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec cette maladie grave. Lectures complémentaires
|
La médecine de précision au service de l’étude du diabète de type 2 dans l’essai COLCOT-T2D

Marie-Pierre Dubé est professeure à l’Université de Montréal et dirige le Centre de pharmacogénomique Beaulieu-Saucier de l’Institut de cardiologie de Montréal. Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en analyse des données de la médecine de précision. Ses recherches concernent les études génomiques d’essais cliniques relatifs aux maladies cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que l’impact du sexe, du genre et de la génétique sur l’efficacité et l’innocuité des médicaments. La Dre Dubé est la chercheuse principale désignée d’un projet financé par une subvention d’équipe des IRSC Mécanismes du diabète et solutions translationnelles. Son équipe étudiera les voies biologiques en cause dans la réaction aux médicaments employés pour traiter le diabète. L’essai clinique appelé COLCOT-T2D étudie un médicament anti-inflammatoire, la colchicine, pour évaluer sa capacité à réduire l’incidence d’événements cardiovasculaires majeurs chez 10 000 patients atteints de diabète de type 2. Son équipe recueillera des échantillons d’ADN et de sang, et aura recours à des techniques génomiques (pour mesurer la variation de l’ADN) et protéomiques (pour mesurer la variation des niveaux de protéines), en plus de mesurer les métabolites médicamenteux en circulation dans le sang. L’étude lui permettra de déterminer quels patients pourraient tirer plus ou moins de bienfaits de la colchicine et d’autres médicaments servant à traiter le diabète. En outre, l’équipe étudiera le rôle du sexe et du genre dans la progression de la maladie, la réaction aux médicaments et la participation à l’étude. La subvention d’équipe permettra de produire des données précieuses qui serviront à améliorer les stratégies de prévention et les options thérapeutiques offertes aux patients atteints de diabète de type 2. Lectures complémentaires
|
Le rôle central de l’autophagie musculaire dans le métabolisme et la santé musculosquelettique

Minna Woo, M.D., Ph. D., est titulaire de la chaire de la famille Ajmera en recherche moléculaire sur le diabète et de la Chaire de recherche du Canada en transduction des signaux dans la pathogenèse du diabète. Professeure au Département de médecine de l’Université de Toronto, elle est également chercheuse principale et chef du groupe de recherche sur le métabolisme à l’Institut de recherche de l’Hôpital général de Toronto (Réseau universitaire de santé). Elle est aussi directrice de la Division de l’endocrinologie et du métabolisme au Réseau universitaire de santé et Système de santé Sinai. Par ses travaux, elle cherche à élucider les mécanismes moléculaires qui déterminent la pathogenèse de la résistance à l’insuline et du diabète de type 2 (DT2). Elle étudie le rôle de la résistance à l’insuline dans les cas de cancer et de maladies cardiovasculaires. La Dre Woo est la chercheuse principale désignée d’un projet financé par une subvention d’équipe des IRSC Mécanismes du diabète et solutions translationnelles. Le diabète de type 2 (DT2) et l’arthrose sont des maladies souvent concomitantes qui sont toutes deux associées à une affection appelée sarcopénie, caractérisée par la perte de masse et de force musculaires durant le vieillissement. L’équipe de la Dre Woo émet l’hypothèse selon laquelle la sarcopénie est un dénominateur commun du DT2 et de l’arthrose. L’autophagie est un processus « d’autodigestion » qui permet d’éliminer les composants cellulaires endommagés. En cas de dysfonction de l’autophagie dans les muscles, ces composants endommagés peuvent s’accumuler et conduire à la sarcopénie. La subvention d’équipe servira à déterminer comment l’autophagie musculaire dysfonctionnelle contribue au DT2 et à l’arthrose. Pour atteindre cet objectif, l’équipe étudiera des modèles murins portant des modifications aux gènes régulateurs de l’autophagie dans le tissu musculaire et surveillera l’apparition de l’arthrose dans ces modèles. L’équipe évaluera également la possibilité de traiter ou d’inverser le DT2 ou l’arthrose en restaurant l’autophagie musculaire par thérapie génique. Enfin, elle prélèvera des échantillons musculaires et sanguins et réalisera une imagerie des genoux de sujets humains atteints de ces maladies, et les analysera afin de déceler des liens génétiques entre le DT2 et l’arthrose et de définir de nouvelles cibles médicamenteuses. Lectures complémentaires
|
Un réseau de phénotypage approfondi pour comprendre la variation des îlots chez l’humain diabétique et en bonne santé

Le Dr Patrick MacDonald, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biologie des îlots, est professeur de pharmacologie à l’Université de l’Alberta. Ses recherches sont axées sur l’étude des mécanismes qui régissent la libération d’hormones des îlots de Langerhans dans le pancréas, et sur leur dérégulation dans le diabète. L’insuline est la principale hormone responsable du contrôle de la glycémie. Les taux de cette hormone, sécrétée par les îlots de Langerhans dans le pancréas, s’élèvent après un repas afin de promouvoir le stockage énergétique, et redescendent à jeun pour permettre la mobilisation énergétique. Les taux d’insuline dans le sang varient énormément d’une personne à l’autre. Des facteurs importants, comme l’alimentation, l’âge, le sexe, la génétique et l’environnement, ont probablement tous un effet sur les taux d’insuline. Cependant, les mécanismes sous-jacents par lesquels ces facteurs influent sur la sécrétion d’insuline par les îlots au niveau cellulaire demeurent obscurs. Le Dr MacDonald est le chercheur principal désigné d’un projet financé par une subvention d’équipe des IRSC Mécanismes du diabète et solutions translationnelles. Son équipe cherche à comprendre la variabilité de la fonction des îlots chez l’humain au regard des effets génétiques et environnementaux sur le risque de diabète, ainsi qu’à définir les mécanismes associés à la dysfonction des îlots dans les cas de diabète. Pour ce faire, l’équipe se servira du vaste corpus de données sur la fonction moléculaire, cellulaire et physiologique des îlots provenant de donneurs d’organe humains. Elle créera également des outils et des ressources pour aider d’autres chercheurs à explorer ces données afin de répondre à leurs propres questions relatives à la dysfonction des îlots qui accompagne le diabète. Lectures complémentaires
|
Traitement du diabète pédiatrique guidé par la médecine de précision : fournir les bons soins aux bons patients, au bon moment et au fil du temps

La Dre Shazhan Amed, M.D., M. Sc., est professeure clinicienne au Département de pédiatrie, Division d’endocrinologie, à l’Université de la Colombie-Britannique. Elle est aussi endocrinologue pédiatrique à l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, à Vancouver. En plus de traiter des enfants et des adolescents atteints de diabète et d’autres affections endocriniennes, la Dre Amed est chercheuse dans le domaine des services de santé et de la santé des populations. Ses recherches portent sur la prévention de l’obésité infantile et du diabète de type 2 chez les jeunes, la surveillance du diabète de type 1 et de type 2 chez l’enfant à l’échelle de la population, l’amélioration de la qualité et la santé numérique. La Dre Amed est la chercheuse principale désignée d’un projet financé par une subvention d’équipe des IRSC Mécanismes du diabète et solutions translationnelles. Son équipe élaborera des stratégies visant à remédier aux lacunes dans la recherche concernant les jeunes diabétiques, qui demeurent plus vulnérables à certaines maladies que les autres jeunes, en plus d’avoir une qualité et une espérance de vie moindres. Le réseau CAPACIty (Canadian pediatric diabetes consortium) est un regroupement de 15 centres consacrés au diabète juvénile partout au Canada qui travaille en partenariat avec des patients, des familles et des professionnels de la santé pour concevoir un registre et une plateforme de recherche sur le diabète pédiatrique pour tout le Canada. Le registre lui permettra d’améliorer le traitement du diabète et les résultats sur la santé pour les jeunes qui en sont atteints grâce à la comparaison de la qualité des soins et des résultats cliniques entre les centres sur le diabète au Canada, des initiatives d’amélioration de la qualité, des projets de recherche axés sur les patients partout au pays et une action revendicatrice efficace. En 2023, la Dre Amed a obtenu une subvention d’équipe des IRSC et de FRDJ « Médecine de précision dans le diabète de type 1 ». Son équipe vise à élargir les capacités du nouvel outil numérique Trustsphere, qui a été élaboré par la clinique consacrée au diabète de l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique afin de résoudre le problème de la dispersion des renseignements et des données sur la santé. Cet outil permet aux patients, à leur famille et à leurs fournisseurs de soins de santé de consulter d’importants renseignements sur le diabète et des recommandations de la clinique à un seul endroit. À l’aide de la collecte d’autres données de patients, comme leurs saines habitudes de vie, l’autoprise en charge du diabète, de même que leur qualité de vie et leur santé mentale, combinées aux données fournies par les capteurs de glucose et les pompes, l’équipe de la Dre Amed vise à cocréer une expérience de soins personnalisée et sur mesure en plus d’améliorer l’autoprise en charge du diabète ainsi que l’expérience et les résultats des patients. Lectures complémentaires
|


Prévenir la perte de vision associée à la rétinopathie diabétique : utiliser les données administratives provinciales sur la santé pour guider le dépistage de la rétinopathie diabétique dans les soins primairesDre Valeria Rac Valeria Rac, M.D., Ph. D., est professeure agrégée à l’Institut des politiques, de la gestion et de l’évaluation de la santé, à l’Université de Toronto. Elle est également chercheuse au Peter Munk Cardiac Centre, au Ted Rogers Centre for Heart Research, ainsi qu’à l’Institut de recherche de l’Hôpital général de Toronto, et elle dirige le Programme d’évaluation des systèmes et des technologies de la santé. La Dre Rac est coresponsable du Programme de dépistage de la rétinopathie diabétique ainsi que du Programme de mobilisation des connaissances, de mise en œuvre et d’évaluation du réseau Action diabète Canada de la SRAP. La Dre Rac est la chercheuse principale désignée d’un projet financé par une subvention d’équipe des IRSC Mécanismes du diabète et solutions translationnelles. Son équipe propose de soutenir le dépistage de la rétinopathie diabétique (RD) dans les soins primaires en utilisant des données administratives provinciales de l’Ontario, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador, afin de déterminer quels patients nécessitent un examen de la vue d’après les recommandations de pratique clinique. La liste de patients ainsi générée sera transmise à un centre de soins communautaires aux fins de la prise de rendez-vous pour de tels examens. La coordination de ce système et les capacités de traitement seront également examinées dans les provinces participantes. Diverses méthodes de recherche seront utilisées pour évaluer l’efficacité et le rapport coût-efficacité des soins, les obstacles à la mise en œuvre du système et les différences liées au sexe et au genre dans la prestation des soins, ainsi que pour cerner les clés du succès. L’objectif général de cette initiative de santé publique consiste à répondre à un besoin de santé non comblé et à préparer le terrain pour la création d’un programme canadien de dépistage de la RD, semblable à ce qui existe au Royaume-Uni, afin d’éliminer la RD comme principale cause de cécité chez les personnes en âge de travailler. Lectures complémentaires
|
Créer des îlots à partir de cellules souches pour traiter le diabète

Le Dr Timothy Kieffer est professeur au Département des sciences cellulaires et physiologiques, au Département de chirurgie et à l’École de génie biomédical de l’Université de la Colombie-Britannique. Son laboratoire se concentre sur la mise au point de nouvelles méthodes de thérapie génique et cellulaire pour traiter le diabète. Le Dr Kieffer est l’actuel scientifique en chef de ViaCyte Inc., où il met à contribution sa connaissance approfondie des thérapies géniques et cellulaires, de la médecine régénérative et de la recherche appliquée sur le diabète, ainsi que son expérience dans l’industrie pour diriger une équipe scientifique axée sur la production et la commercialisation d’interventions cliniques contre le diabète. Le Dr Kieffer est le chercheur principal désigné d’un projet financé par une subvention d’équipe des IRSC Mécanismes du diabète et solutions translationnelles. Les personnes atteintes du diabète de type 1 sont privées des cellules qui libèrent l’insuline, et les injections quotidiennes d’insuline demeurent le moyen courant de stabiliser leur glycémie et d’assurer leur survie. Au cours des dernières années, des progrès remarquables ont été accomplis dans la compréhension du processus de développement naturel des cellules des îlots sécrétrices d’insuline dans le corps humain. Ainsi, il est aujourd’hui possible de reproduire en laboratoire de nombreuses étapes de ce processus avec des cellules souches cultivées afin de créer des cellules sécrétrices d’insuline. Dans des essais cliniques en cours, des précurseurs d’îlots créés à partir de cellules souches cultivées sont chargés dans des dispositifs microscopiques pour être implantés sous la peau. Bien que les évaluations initiales des patients soient encourageantes, la production d’insuline par les dispositifs contenant des cellules est actuellement insuffisante pour inverser complètement le diabète. L’équipe du Dr Kieffer a pour objectif d’améliorer significativement la fabrication des îlots et d’ainsi consolider le transport de l’insuline afin d’optimiser le processus de production de masse d’îlots dérivés de cellules souches qui constitueront la base de nouveaux essais cliniques sur des patients atteints du diabète de type 1. Lectures complémentaires
|
Premier essai sur l’utilisation d’îlots dérivés de cellules souches pluripotentes induites (CSPi) autologues sur des humains : personnaliser le traitement du diabète
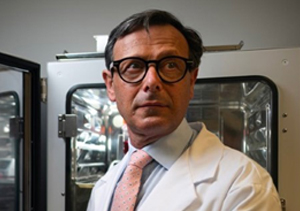
James Shapiro, M.D., Ph. D., est professeur de chirurgie, de médecine et de chirurgie oncologique et directeur des programmes de transplantation clinique d’îlots et de greffes de foie provenant de donneurs vivants, à l’Université de l’Alberta. Le programme de transplantation clinique d’îlots qu’il dirige figure parmi les plus importants au monde avec des centaines de patients traités. Ses recherches actuelles reposent sur le Protocole d’Edmonton, selon lequel des cellules saines d’îlots pancréatiques sont transplantées dans le foie d’un patient atteint du diabète de type 1 (DT1). Il cherche à accroître en qualité et en nombre les organes donnés et à étudier le recours aux technologies des cellules souches en médecine régénérative comme traitement potentiel du diabète. Le Dr Shapiro est le chercheur principal désigné d’un projet financé par une subvention d’équipe des IRSC Mécanismes du diabète et solutions translationnelles. Le diabète est causé par la privation d’insuline, une hormone sécrétée par les cellules bêta des îlots pancréatiques qui régule la glycémie. Dans le DT1 (~10 %), les cellules bêta sont détruites par le système immunitaire des patients. Dans le diabète de type 2 (DT2, ~90 %), l’organisme devient plus résistant à l’insuline, ce qui en augmente la demande et finit par endommager les cellules bêta. L’équipe du Dr Shapiro mettra au point un traitement à base de cellules souches visant à remplacer ou à renforcer les cellules bêta endommagées chez les personnes atteintes de diabète, tous types confondus. Elle propose de fabriquer de nouvelles cellules semblables aux cellules bêta à partir des propres cellules sanguines des patients, ce qui en assurera l’acceptation par le système immunitaire et éliminera ou réduira le besoin de médicaments antirejet. Dans ce premier essai sur des humains, les membres de son équipe implanteront ces cellules sous la peau des patients et en évalueront l’innocuité et l’efficacité préliminaire. Les protocoles de fabrication seront optimisés pour permettre la mise au point et l’application à plus grande échelle de produits de qualité clinique à des fins thérapeutiques. La possibilité de transplanter une quantité illimitée d’îlots à partir des propres cellules des patients, éliminant ainsi le besoin d’immunosuppresseurs, ouvre de nouvelles possibilités dans le traitement de toutes les formes de diabète et pourrait devenir le premier traitement fonctionnel au monde. Lectures complémentaires
|
L’immunométabolisme dans le diabète : exploiter le dialogue métabolique entre les îlots et les cellules immunitaires à des fins thérapeutiques

Le Dr Bruce Verchere est professeur au Département de chirurgie et au Département de pathologie et de médecine de laboratoire de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), directeur du Centre de médecine et de thérapeutique moléculaires de l’Université de la Colombie-Britannique et chercheur à l’Institut de recherche de l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique. Par ses recherches, il tente de comprendre le fonctionnement normal des cellules bêta pancréatiques et la raison pour laquelle elles sont dysfonctionnelles et meurent dans les cas de diabète de type 1 et de type 2 et après une transplantation d’îlots. Il est titulaire de la chaire de recherche Irving-K.-Barber sur le diabète de la UBC et ancien directeur du Canucks for Kids Fund Childhood Diabetes Laboratories à l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique. Le Dr Verchere est le chercheur principal désigné d’un projet financé par une subvention d’équipe des IRSC Mécanismes du diabète et solutions translationnelles. Il a réuni une équipe d’experts exceptionnels dans les domaines du diabète et de la biologie des cellules immunitaires et des cellules bêta sécrétrices d’insuline afin d’étudier pourquoi le système immunitaire attaque les cellules bêta et cause le diabète de type 1 (DT1). Son équipe se concentrera sur un champ de recherche en croissance, l’immunométabolisme, qui s’intéresse notamment à l’étude de l’incidence des voies métaboliques des cellules immunitaires sur leur capacité de se diviser et de fonctionner. Elle utilisera des échantillons de souris ou d’êtres humains en santé ou atteints du DT1 pour étudier comment la maladie peut altérer les voies métaboliques cellulaires. Elle examinera aussi l’influence possible de facteurs produits par les cellules bêta elles-mêmes sur l’activité métabolique des cellules immunitaires. Ces travaux pourraient mener à de nouvelles interventions destinées à inhiber l’auto-immunité. L’équipe prévoit aussi recourir à de nouvelles méthodes de génie génétique pour agir sur la capacité des cellules immunitaires de répondre aux facteurs fabriqués par les cellules des îlots pancréatiques ou pour modifier l’activité de certaines voies métaboliques particulières des cellules immunitaires. Ces travaux permettront de comprendre l’influence de l’altération du métabolisme sur l’auto-immunité et pourraient donner lieu à de nouveaux moyens d’agir sur des processus métaboliques clés afin de prévenir le DT1 ou d’en ralentir la progression. Lectures complémentaires
|
Les origines développementales du diabète pédiatrique de type 2 et de la dysfonction rénale précoce

Brandy Wicklow est endocrinologue pédiatrique à l’Hôpital pour enfants de Winnipeg, professeure agrégée à l’Université du Manitoba et clinicienne-chercheuse à l’Institut de recherche de l’Hôpital pour enfants du Manitoba. Ses recherches sont axées sur les déterminants du diabète de type 2 (DT2) chez l’enfant, plus particulièrement chez les populations autochtones du Nord du Manitoba (Canada), avec lesquelles elle collabore étroitement dans le contexte des soins cliniques et de la recherche. La Dre Wicklow est la chercheuse principale désignée d’un projet financé par une subvention d’équipe des IRSC Mécanismes du diabète et solutions translationnelles. Son étude a pour but de définir les mécanismes par lesquels l’exposition au DT2 in utero et la mutation G319S influent sur le développement et le fonctionnement des cellules bêta du pancréas et des néphrons du rein, et de déterminer le rôle de la programmation épigénétique dans la transmission du risque de l’exposition au DT2 in utero au dysfonctionnement des cellules bêta et du rein. Au terme de l’étude, l’équipe espère mieux comprendre comment la santé des cellules bêta pancréatiques et des reins des nourrissons est influencée par l’exposition au diabète in utero et le variant du gène HNF1a; identifier des biomarqueurs permettant de détecter à la naissance les enfants les plus à risque de DT2; et guider la mise au point de nouveaux traitements pour prévenir le DT2 et les complications rénales chez les enfants exposés au diabète. Lectures complémentaires
Twitter: |
Le microbiome peut-il être la solution au traitement des maladies humaines?Des chercheurs étudient la relation entre les microbes et l’intestin 
L’intestin humain est un univers mystérieux renfermant des milliards de bactéries et d’autres microbes. Les scientifiques savent depuis longtemps qu’une communauté microbienne intestinale saine est essentielle pour la santé, mais les tentatives d’utiliser des probiotiques, ou des bactéries bénéfiques, pour traiter les maladies n’ont montré que des résultats mitigés. Or, le Dr Alain Stintzi et son équipe, en collaboration avec le Dr Mack du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario et le Dr Figeys de l’Université d’Ottawa, mènent présentement un essai clinique en suivant une nouvelle approche. Plutôt que de fournir des probiotiques aux patients, les chercheurs leur donnent des suppléments de fibres personnalisés, qui constituent une source de nutriments pour les microbes bénéfiques. Les participants à l’essai clinique sont des enfants vivant avec une maladie inflammatoire de l’intestin, soit la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn. Les suppléments de fibres qu’ils reçoivent ont été soigneusement adaptés à leur microbiome intestinal dans le but de modifier la composition de leur communauté microbienne et d’accélérer la production de métabolites bénéfiques. La recherche du Dr Stintzi permettra d’examiner le rôle du microbiome dans la maladie ainsi que la relation causale entre les microbes intestinaux et l’inflammation. Comme il faudra attendre au moins un an avant d’observer des résultats, l’équipe de recherche espère que l’essai clinique mènera à de nouveaux traitements contre les maladies inflammatoires de l’intestin et à l’amélioration de la qualité de vie de la population canadienne. Lecture connexe |
La recherche sur le VIH/sida en tant qu’élément transformateurComprendre le VIH non seulement comme une maladie, mais aussi comme un moteur pour les mouvements sociaux 
La Dre Ciann Wilson a commencé sa carrière comme étudiante en biologie humaine à l’Université de Toronto, mais un cours inspirant sur la sociologie du VIH/sida donné par un professeur qu’elle respectait a tout changé. Ce cours visait à examiner en profondeur les facteurs sociaux et structurels qui rendent les communautés plus vulnérables aux maladies, et il a donné une nouvelle orientation à la carrière de la Dre Wilson. Aujourd’hui, la Dre Wilson travaille avec des communautés queers, trans, noires, autochtones et racialisées. Elle aborde le VIH sous l’angle des déterminants sociaux de la santé examinant les conditions sociétales, économiques, politiques et environnementales qui déterminent les résultats cliniques. Comme l’explique la Dre Wilson, si une grande partie de la recherche en santé reste descriptive et axée sur le niveau du comportement individuel, il est nécessaire d’adopter un point de vue plus large pour mieux comprendre pourquoi certaines communautés sont plus vulnérables aux maladies chroniques. Elle estime que la recherche en santé peut et doit aller au-delà de la documentation et du dénombrement des décès des communautés marginalisées dans une optique intersectionnelle. Pour apporter un changement transformateur dans la société, la recherche en santé doit inclure une analyse sociale et structurelle plus nuancée; une analyse qui reconnaît que les communautés vulnérables sont des survivantes ingénieuses de la violence systémique sous forme de racisme, de colonialisme, d’homophobie, de transphobie et de classisme, pour n’en citer que quelques-uns. La Dre Wilson s’efforce d’utiliser ses recherches pour élaborer de nouveaux programmes de santé sexuelle, documenter les expériences en matière de santé des communautés noires, autochtones et racialisées, ainsi que pour remettre en question les politiques et faire pression en faveur de changements dans la formation à la recherche en santé. Elle souhaite que les besoins des Noirs, des Autochtones et des personnes racialisées soient pris en compte, car elle est convaincue que si nous répondons aux besoins des personnes les plus marginalisées sur le plan intersectoriel, tout le monde (c’est-à-dire l’ensemble de la population canadienne) participera à l’amélioration de notre santé. |
La physique ouvre la voie à une meilleure transplantation rénaleUn chercheur postdoctoral utilise la photoacoustique pour mettre au point de nouveaux outils d’imagerie pour les reins de donneurs 
Les transplantations rénales offrent un nouveau souffle aux patients souffrant d’une maladie rénale chronique, mais les dons diffèrent les uns des autres au chapitre des possibilités. La qualité de l’organe donné peut influer sur le résultat de la chirurgie et sur le fonctionnement du rein dans les années qui suivent la transplantation. Les reins provenant de donneurs malades présentent généralement des cicatrices, appelées fibrose, et les résultats qu’ils offrent sont moins bons que pour les reins en santé. En outre, la forte demande de transplantations rénales peut contraindre les médecins à accepter des dons qui ne sont pas optimaux pour la transplantation. Le Dr Eno Hysi, boursier Banting et KRESCENT à l’Hôpital St. Michael de Toronto, l’un des plus grands centres de transplantation rénale au Canada, aide à résoudre l’un des problèmes les plus pressants auxquels sont confrontés les néphrologues : l’incapacité de déterminer la présence de fibrose dans les transplantations rénales. Physicien de formation, le Dr Hysi utilise ses connaissances sur la façon dont la lumière et le son voyagent dans les tissus biologiques, ou photoacoustique, pour mettre au point des outils d’imagerie non invasifs qui permettent aux spécialistes des transplantations de sélectionner le rein le plus approprié en cartographiant le degré de fibrose présent au moment de la chirurgie. Cette recherche permet de mieux utiliser les rares organes de donneurs et peut également contribuer à améliorer les résultats des transplantations pour les Canadiennes et Canadiens. Le Dr Hysi a reçu le prix Polanyi 2021 de physique (en anglais seulement) pour son remarquable travail. Lecture connexe : |
Une bonne santé pour tousPleins feux sur l’accessibilité des soins de santé et des services communautaires pour les personnes marginalisées au Canada 
Les maladies infectieuses comme le VIH, l’hépatite C et la COVID-19 touchent de façon disproportionnée les personnes marginalisées au Canada. Par exemple, en 2019, la proportion la plus élevée de cas signalés d’adultes ayant été exposés au VIH/sida était celle des hommes gais, bisexuels ou ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (39,7 %), suivie des cas attribués à des contacts hétérosexuels (28,3 %) et des cas parmi les utilisateurs de drogues injectables (21,5 %). Pour renverser cette tendance, le Dr Souleymanov s’est efforcé de rendre les soins de santé, les services communautaires et les programmes sociaux accessibles à certaines des communautés les plus exclues et marginalisées du Canada. Au cours des deux dernières années, le Dr Souleymanov a reçu plus de 1,2 million de dollars en subventions des IRSC pour mener son programme de recherche. Ses travaux visent à élaborer des modèles de soins de santé et de services communautaires adaptés aux différences culturelles. L’un de ses principaux centres d’intérêt est l’optique indispensable de la science sociale dans la réduction des méfaits et la lutte contre les maladies infectieuses. S’inspirant de sa propre expérience et des 12 années qu’il a passées en tant que spécialiste de la recherche communautaire sur le VIH et la réduction des méfaits en Ontario et au Manitoba, le Dr Souleymanov vise non seulement à prévenir les disparités sociales et les disparités en santé, mais aussi à promouvoir le bien-être dans les populations prioritaires. De plus, son travail auprès du Village Lab appuie la recherche communautaire et améliore la santé de ces populations. |
Soins de qualité pour les femmes infectées par le VIHVeiller à ce que les femmes vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ne soient pas exclues de la recherche sur les maladies infectieuses 
Les femmes vivant avec le VIH constituent la moitié de toutes les personnes vivant avec le VIH dans le monde, mais comparés aux hommes vivant avec le VIH, leurs cas restent considérablement peu étudiés. C’est ici que les recherches de Melanie Murray entrent en jeu. Experte en maladies infectieuses à l’Université de la Colombie-Britannique, chercheuse principale à l’étude CARMA : CHIWOS de la Colombie-Britannique et clinicienne à la Oak Tree Clinic, la Dre Murray s’occupe des femmes vivant avec le VIH, et ce, à toutes les étapes de leur vie, en mettant davantage l’accent sur la dysrégulation hormonale et les troubles comorbides liés au vieillissement. Dre Murray fait participer des organismes offrant des services relatifs au traitement du VIH et des femmes vivant avec le VIH à chaque étape de sa recherche, y compris à titre d’associés de recherche pairs rémunérés qui gèrent les questionnaires de l’étude. De plus, bon nombre des questions qu’elle aborde dans sa recherche proviennent directement des patients, il s’agit donc véritablement d’une recherche axée sur le patient. Dre Murray affirme que les deux aspects les plus gratifiants de son travail sont les suivants :
Dans le cadre de sa pratique, la Dre Murray est en train d’améliorer notre compréhension du VIH et des femmes, du VIH et du vieillissement, ainsi que des déterminants structurels et psychosociaux des femmes atteintes de cette maladie. Lecture connexe : |
Quand le stress atteint son paroxysmeUn chercheur trouve des solutions aux crises modernes 
Le concept de crise est au cœur des travaux de recherche du Dr Kiffer Card. Ce chercheur en services de santé de l’Université Simon-Fraser s’est bâti une carrière en étudiant les effets du stress sur les personnes et sur les institutions, le moment où ce stress se transforme en détresse et le moment où la détresse croissante devient une crise, qu’elle soit personnelle ou sociétale. Le stress fait partie de la vie. Cependant, selon le Dr Card, lorsque les personnes — ou nos institutions — ne veulent pas ou ne peuvent pas le soulager, il se transforme en détresse. Les recherches du Dr Card portent sur les moyens d’atténuer le stress et d’éviter que la situation ne dégénère en crise. Au début de sa carrière en santé publique, le Dr Card travaillait dans le domaine de la qualité de l’environnement intérieur; dans ces fonctions, il devait résoudre les préoccupations des étudiants universitaires qui étaient en conflit avec leurs propriétaires au sujet de la qualité de leur logement. Il a ensuite fait des études supérieures durant lesquelles il s’est initié à la recherche sur le VIH, suivies d’études postdoctorales sur la consommation de psychotropes. Aujourd’hui professeur adjoint, il étudie les changements climatiques et la solitude, qu’il qualifie de « grandes crises de notre époque ». En tant qu’épidémiologiste social s’intéressant à un ensemble diversifié de sujets de recherche — comme l’utilisation de « prescriptions sociales » (telles que le temps passé dans la nature) pour offrir des soins de première ligne holistiques ou les répercussions des changements climatiques et du néolibéralisme sur la santé mentale —, le Dr Card examine les principales crises de notre époque en tenant compte à la fois des personnes et des systèmes. Le Dr Card a reçu une bourse d'impact sur le système de santé des IRSC en 2018 et le Prix de l’étoile montante en recherche de l’ISPS des IRSC en 2020. Lectures connexes
|
Le VIH et le microbiome génitalConcevoir de nouveaux moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH 
Depuis que les premiers cas de VIH ont été signalés il y a plus de 40 ans, près de 80 millions de personnes ont été infectées par le virus, et 36 millions sont décédées de maladies liées au sida. Aujourd’hui, dans le monde, près de 38 millions de personnes vivent avec le VIH, et plus d’un million de personnes sont nouvellement infectées chaque année. Bien que les efforts mondiaux aient permis de réduire les infections, d’améliorer l’accès aux traitements et de sauver des vies, il demeure crucial de mettre au point de nouvelles approches pour prévenir les infections. La Dre Jessica Prodger, professeure adjointe à l’Université Western, a observé pour la première fois les effets dévastateurs du VIH alors qu’elle poursuivait ses études supérieures dans l’Ouganda au milieu des années 2000. Les médicaments contre le VIH sont devenus largement accessibles en Ouganda en 2006, alors qu’ils l’étaient déjà plus de dix ans plus tôt en Amérique du Nord. Cette expérience a incité la Dre Prodger à orienter ses recherches à l’Université Western sur la prévention de la transmission sexuelle du VIH, afin de contribuer à endiguer l’épidémie de VIH en Afrique subsaharienne. La Dre Prodger étudie le rôle du microbiome génital dans la transmission du VIH. Les relations hétérosexuelles non protégées sont l’une des causes courantes de nouvelles infections. Le prépuce est le principal site de transmission chez l’homme, et l’on sait que les bactéries qui vivent sous le prépuce jouent un rôle dans la vulnérabilité à l’infection. C’est pourquoi la circoncision masculine peut réduire considérablement le risque de contracter le VIH. Cela pourrait également expliquer pourquoi certains hommes exposés au VIH lors de relations sexuelles non protégées avec une personne séropositive qui n’est pas sous traitement sont moins susceptibles d’être infectés. Dans le cadre de son programme de recherche, la Dre Prodger étudie des prélèvements péniens et des échantillons de tissus provenant d’hommes adultes de l’Ouganda ayant subi une circoncision volontaire, afin de mettre en évidence les bactéries et les cellules immunitaires susceptibles de favoriser ou de prévenir l’infection par le VIH. Ses travaux nous aideront à mieux comprendre l’interaction et la communication entre le microbiome pénien et les tissus humains, ainsi que la manière dont cette relation peut influencer la transmission du virus. Les résultats de ces travaux pourraient contribuer à la mise au point de vaccins et de microbicides pour la prévention du VIH. Lectures connexes : |
Améliorer la santé des femmes autochtones vivant avec le VIHUne chercheuse autochtone travaille et apprend aux côtés de femmes autochtones vivant avec le VIH 
Depuis 16 ans, Carrie Martin, une Mi'gmaq, travaille avec des femmes autochtones vivant avec le VIH et d’autres infections transmissibles sexuellement et par le sang. En tant que membre du milieu de la recherche communautaire, son approche est fondée sur les systèmes de connaissances et du savoir-faire autochtones et sur la décolonisation. « Il était évident que les disparités en matière de santé étaient bien réelles et perpétuées par un système marqué par la discrimination et le racisme systémique, qui empêchait les femmes autochtones de jouir d’une qualité de vie semblable à celle de leurs homologues canadiennes », explique Mme Martin en parlant de ses premières prises de conscience lorsqu’elle a commencé à travailler pour le Foyer pour femmes autochtones de Montréal à 21 ans. C’est un combat difficile mais gratifiant pour Mme Martin. Elle a mis sur pied un centre médical hébergé par le Foyer pour femmes autochtones et, en 2008, a cofondé le Centre de santé autochtone de Tio'tia:ke. Elle a aussi reçu une subvention de 3 469 000 $ des IRSC pour diriger un projet intitulé Measuring Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR): Responding to the Needs of Indigenous Women and Girls in a Global Context [Mesurer la santé et les droits sexuels et reproductifs : répondre aux besoins des femmes et des filles autochtones partout dans le monde], qui sera mis en œuvre dans sept pays sur une période de cinq ans. Ce projet permettra d’améliorer la collecte, l’utilisation et l’échange des données, et d’accroître les partenariats pour faciliter la prise en charge de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Dans son travail, Mme Martin s’efforce d’inclure les femmes autochtones cis et trans, ainsi que les personnes de genre queer et s’identifiant comme fems. Son travail dévoué, maintenant en grande partie au sein du Réseau canadien autochtone du sida (RCAS) et avec le soutien financier des IRSC, vise à créer un monde plus équitable pour les femmes vivant avec des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Lectures connexes : |
Mesurer l’itinérance et les toxicomanies chez les Autochtones en milieu urbain à l’aide de cadres conceptuels autochtones
Université de Toronto D’ascendance mixte (Premières Nations et colons européens), Stephanie McConkey est une étudiante au doctorat du Département d’épidémiologie de l’Université de Toronto. Ses recherches portent sur la mesure de l’itinérance et des toxicomanies chez les Autochtones en milieu urbain. En se fondant sur les 12 dimensions de l’itinérance définies par Jesse Thistle (2017), elle travaille à la formulation d’un indicateur pouvant être utilisé pour mesurer spécifiquement l’itinérance chez les Autochtones et la multitude de facteurs qui y contribuent, ainsi que son incidence sur la consommation de substances psychoactives chez les peuples autochtones vivant en milieu urbain et sur les terres connexes. Étant donné que l’indicateur actuel de l’itinérance de Thistle s’applique aux communautés autochtones et non autochtones, il ne rend pas compte de toute l’expérience et des besoins des peuples autochtones, ni des facteurs uniques qui contribuent à l’itinérance autochtone. Mme McConkey se consacre à l’élaboration d’un modèle qui prend en compte les facteurs sociaux, coloniaux et structurels qui influencent l’itinérance autochtone. Pour ce faire, elle travaille en partenariat avec des Autochtones, ce qui permet aux partenaires communautaires de codiriger la recherche, y compris la définition de la question et des objectifs de recherche, le travail de conception et d’analyse, l’interprétation des résultats et toutes les activités d’application des connaissances. Mme McConkey puise son inspiration et sa motivation de sa propre famille, dont certains membres ont connu l’itinérance ou la toxicomanie au cours de leur vie. Elle est particulièrement passionnée par l’utilisation de cadres conceptuels théoriques autochtones pour élaborer des modèles statistiques, ce qui lui permet de s’éloigner des données habituelles fondées sur les lacunes pour établir des statistiques qui célèbrent la résilience autochtone. Elle espère que cette recherche contribuera à combler le fossé créé par la division sociale et l’iniquité dont souffrent les itinérants autochtones en milieu urbain. Lectures connexes : |
Une alliée des femmes vivant avec le VIHAméliorer les résultats cliniques et l’équité en santé pour toutes les femmes vivant avec le VIH 
Lorsque les premiers cas de VIH ont été signalés au début des années 1980, on a d’abord pensé que cette maladie ne concernait que les hommes homosexuels. Plus de 40 ans plus tard, nous savons que l’épidémie de VIH a touché tout le monde, peu importe le sexe. En effet, les femmes représentent plus de la moitié des quelque 38 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Au Canada, les femmes représentent le quart du nombre total de personnes vivant avec le VIH, estimé à plus de 62 000 personnes en 2018, et cette proportion tend à s’accroître. Bien que le traitement antirétroviral ait transformé le VIH, d’une maladie autrefois mortelle en une maladie chronique, les obstacles demeurent bien présents pour les personnes vivant avec le VIH : difficulté d’accès aux traitements et aux soins de qualité, stigmatisation et discrimination. Les effets de cette stigmatisation touchent de manière disproportionnée les femmes – surtout les femmes racisées, autochtones et issues de la diversité de genre. Pendant plus de 30 ans, la Dre Mona Loutfy a défendu les intérêts des femmes qui vivent avec le VIH ou qui sont touchées par la maladie. Dans les années 1990, alors qu’elle poursuivait sa formation médicale à l’Hôpital Wellesley de Toronto, la Dre Loutfy a constaté les effets dévastateurs du VIH sur ses patients ainsi que les facteurs sociaux qui influent sur les personnes ciblées par l’infection, les soins qu’elles reçoivent et leurs résultats de santé. Cette expérience a suscité en elle un désir de défendre l’équité en santé et la justice sociale, désir qui s’est renforcé au cours de son travail des 30 dernières années en tant que clinicienne-chercheuse. En 2006, la Dre Loutfy a créé le Programme de recherche sur les femmes et le VIH, qui s’appuie sur la recherche communautaire et l’expérience des femmes vivant avec le VIH pour réaliser des recherches essentielles visant à optimiser les soins aux femmes vivant avec le VIH, ainsi que leur vie et celle de leur famille. En partenariat avec des dirigeants communautaires, la Dre Loutfy et son équipe ont largement contribué au domaine de la santé reproductive et du VIH et ont eu une profonde influence sur la vie des femmes noires, autochtones et trans vivant avec le VIH. La Dre Loutfy a dirigé l’élaboration de lignes directrices nationales en matière de planification de la grossesse, qui ont permis aux personnes vivant avec le VIH de réaliser leur rêve d’avoir des enfants et de devenir parents tout en empêchant la transmission du virus à leurs bébés et à leurs partenaires. Elle a également dirigé l’Étude sur la santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec le VIH au Canada, une étude longitudinale de recherche communautaire qui vise à créer des connaissances pour améliorer la santé et le bien-être des femmes vivant avec le VIH au Canada. En 2022, la Dre Loutfy a reçu la plus haute distinction en recherche sur le VIH au Canada et a été invitée à prononcer la Conférence Mark‑Wainberg, tenue par l’Association canadienne de recherche sur le VIH (ACRV). Elle a également reçu le Prix d’excellence en recherche ACRV-CANFAR (Fondation canadienne de recherche sur le sida) et le Michael Gordon Award for Humanism in Medicine du Département de médecine de l’Université de Toronto. Lectures connexes :
|
Comprendre les besoins en soins de santé et en services sociaux de la population adulte autochtone vieillissante

La Dre Sharlene Webkamigad est une infirmière autorisée faisant actuellement un doctorat interdisciplinaire sur la santé en milieux ruraux et nordiques à l’Université Laurentienne. Ses recherches visent à améliorer les soins de santé de la population autochtone vieillissante, qui présente des taux plus élevés de maladies chroniques que tout autre groupe, et qui privilégie le choix de vieillir et de mourir chez soi. La Dre Webkamigad cherche à définir les besoins en matière de soins de santé et de services sociaux auxquels sont confrontés les aînés autochtones vivant en dehors des établissements de soins de longue durée et leurs soignants afin d’élaborer un modèle et des politiques adaptés à ceux-ci, ainsi qu’à leurs préférences et à leurs priorités. Ses recherches actuelles se concentrent sur les communautés des Premières Nations de la Nation Anishinabek. Appliquant une approche participative communautaire, la Dre Webkamigad cherche à cerner les perceptions des aînés autochtones et de leurs soignants quant à l’impact du soutien communautaire offert pendant la pandémie de COVID-19. Après avoir consulté le directeur de la santé et du bien-être communautaire et obtenu l’approbation du Chef et du Conseil d’Atikameksheng Anishinawbek, un collectif formé de fournisseurs de soins de santé, de leaders communautaires et d’aînés a joué un rôle essentiel dans le déroulement de cette recherche. Cette collaboration a notamment contribué à créer des programmes locaux de soins palliatifs et des cadres de services témoignant d’une sécurité culturelle, tout en renforçant l’autodétermination des conseils tribaux. Petite-fille d’un survivant des pensionnats, la Dre Webkamigad a personnellement été témoin des défis auxquels les aînés des Premières Nations et leurs soignants sont confrontés dans la prise en charge de leur santé et de leur bien-être. À travers les témoignages d’autres survivants des pensionnats, elle entend continuer à s’intéresser aux influences historiques et coloniales ayant un impact sur la santé des personnes âgées autochtones et à œuvrer pour l’amélioration du système de santé en ce sens. Lectures connexes : |
Exploration des bienfaits de la danse métisse sur la santéPrivilégiant une approche holistique à la façon dont la culture et le soutien social influent sur la santé cardiovasculaire 
Professeure adjointe, Université de la Saskatchewan La Dre Heather Foulds est professeure adjointe à l’Université de la Saskatchewan. Ses travaux actuels portent sur la santé et le bien-être au sein de la communauté métisse. Privilégiant une approche holistique, Dre Heather Foulds s’intéresse à la façon dont la culture et le soutien social influent sur la santé cardiovasculaire et cherche à cerner l’importance de la danse métisse comme facteur de santé, à la fois comme activité physique et comme expression culturelle. Étant elle-même métisse, la Dre Foulds voue un intérêt particulier à ce domaine de recherche vu le sentiment identitaire et le lien culturel qu’il suscite. Membre d’une troupe de danse métisse depuis maintenant cinq ans, elle a pu tirer parti de ses relations avec ses partenaires, ainsi qu’avec d’autres membres et conseillers de la communauté autochtone. Elle s’est ainsi penchée sur les implications culturelles et sociales de la renaissance de la danse métisse pour la communauté autochtone, notamment quant à son histoire, son symbolisme et ses récits. Dans l’avenir, la Dre Foulds aspire à faire connaître plus amplement la danse métisse et inciter les non-Autochtones à la pratiquer. Par l’analyse de divers facteurs, notamment l’expérience vécue des nouveaux adeptes et des données telles que la consommation d’oxygène, la Dre Foulds parvient à mesurer l’intensité physique de la danse et à en explorer les bienfaits sur la santé physique. Cette démarche offre également à chacun la possibilité de se rappeler l’histoire coloniale du Canada, tout en contribuant à préserver les savoirs des peuples autochtones. Ce dernier volet s’ajoute aux données plus qualitatives de ce projet d’étude dont la visée est les retombées positives de cette pratique sur la santé cardiovasculaire. Lectures connexes : |
Devenir un superhéros scientifique!Des ressources pour la recherche pédiatrique créées par des enfants 
Le Réseau des réseaux (N2) est une alliance de réseaux et d’organisations de recherche canadiens qui s’efforcent d’améliorer les capacités de recherche clinique nationales. Rassemblant des spécialistes en essais cliniques et des professionnels de recherche clinique des quatre coins du pays, N2 offre une plateforme commune pour la mise en commun des pratiques exemplaires, des ressources et du contenu lié à la recherche afin de garantir une recherche efficace et de haute qualité, l’intégrité des pratiques cliniques et la responsabilisation. En tant que présidente du Comité d’éducation et de sensibilisation sur les essais cliniques de N2, Daniela Bianco dirige une équipe multidisciplinaire et travaille avec elle à développer des ressources et des outils d’éducation et de sensibilisation visant à accroître les connaissances et la compréhension du public relativement à la recherche clinique. Le Comité a récemment produit une vidéo amusante qui constitue la première partie d’une boîte à outils destinée à faire participer les enfants et leurs familles, et à les aider à s’informer sur la recherche et les essais cliniques. La vidéo vise à encourager les enfants à devenir des « participants » en s’inscrivant à des études de recherche clinique. Elle présente un participant réel et survivant du cancer à trois reprises qui parle de sa participation aux essais cliniques et explique pourquoi la recherche est si importante. La vidéo du Comité « The Participators» (en anglais seulement) a reçu une mention spéciale lors du concours de vidéos Entretiens de l’IDSEA 2021. Visitez la chaîne YouTube d’Entretiens de l’IDSEA pour visionner toutes les vidéos présentées dans le cadre du concours de 2021 et plus encore. Apprenez-en davantage sur le concours annuel de vidéos Entretiens de l’IDSEA. |
Projet de recherche « Teens Talk Vaping »Il est temps de faire participer les adolescents à la recherche sur le vapotage chez les jeunes 
Le Laboratoire d’analyse de l’environnement humain (HEAL) de l’Université Western se spécialise dans la production, l’évaluation, la synthèse, la diffusion et la mobilisation de données scientifiques pour soutenir des politiques, des programmes et des pratiques professionnelles efficaces visant à créer des communautés saines et dynamiques. « Teens Talk Vaping » est un projet de recherche « par et pour les jeunes », dirigé par le Dr Jason Gilliland (directeur de HEAL et professeur à l’Université Western) et la Dre Stephanie Coen (professeure agrégée à l’Université de Nottingham, professeure auxiliaire de recherche à l’Université Western et membre associée du corps professoral à HEAL), qui cherche à comprendre les points de vue des adolescents sur le vapotage. L’objectif est de mieux comprendre les expériences et les idées des adolescents sur le vapotage, ainsi que la place du vapotage dans leur vie quotidienne. Dans le cadre du projet, les adolescents co-chercheurs et les membres du conseil consultatif des jeunes de HEAL (en anglais seulement) ont produit une vidéo présentant les principaux thèmes relatifs au vapotage qui sont ressortis des groupes de discussion auxquels ont pris part les participants au projet âgés de 13 à 19 ans. La vidéo adopte un point de vue à la première personne et suit le cours d’une journée dans la vie d’un étudiant du secondaire fictif, qui est exposé au vapotage dans les toilettes de l’école, aux fêtes les fins de semaine où le vapotage est très répandu, et aux médias sociaux où le vapotage est omniprésent. Elle rend compte de certaines des tensions auxquelles les adolescents sont confrontés alors qu’ils doivent prendre des décisions au quotidien face à toutes les occasions de vapotage qui se présentent à eux. La vidéo de HEAL « Teens Talk Vaping » (en anglais seulement) a reçu une mention spéciale lors du concours de vidéos Entretiens de l’IDSEA 2021. Visitez la chaîne YouTube d’Entretiens de l’IDSEA pour visionner toutes les vidéos présentées dans le cadre du concours de 2021 et plus encore. Apprenez-en davantage sur le concours annuel de vidéos Entretiens de l’IDSEA. |
Promouvoir la résilience chez les jeunes victimes de violence interpersonnelleImplanter des pratiques d’intervention et de prévention efficaces 
Les travaux de la Dre Hébert et des membres de son laboratoire de recherche à l’Université du Québec à Montréal portent sur l’agression sexuelle des enfants et la violence dans les relations amoureuses des jeunes. Ces travaux visent à identifier les différents facteurs de protection qui peuvent agir sur les plans individuel, familial, social et communautaire pour réduire les impacts de la victimisation. Les différents projets, réalisés en étroit partenariat avec les milieux de pratique, visent aussi à promouvoir l’adoption de d’interventions exemplaires afin de favoriser le développement optimal des jeunes. Les recherches permettent également d’évaluer des programmes de prévention visant à enrayer la violence. Malgré la prévalence élevée du phénomène, la lourdeur qui représente la problématique de l’agression sexuelle envers les jeunes, il est essentiel de porter un message d’espoir basé sur les résultats des recherches pour les victimes, les adultes significatifs, les intervenantes et intervenants en mettant l’emphase sur les facteurs pouvant promouvoir la résilience chez ces populations vulnérables. La vidéo de la Dre Hébert intitulée « Agressions sexuelles envers les enfants » a remporté la troisième place de l’édition 2021 du concours Entretiens de l’IDSEA. Visitez la chaîne YouTube d’Entretiens de l’IDSEA pour visionner toutes les vidéos présentées dans le cadre du concours de 2021 et plus encore. Apprenez-en davantage sur le concours annuel de vidéos Entretiens de l’IDSEA. |
Craintes de se rendre au service des urgences pendant la pandémie de COVID-19Ne les laissez pas vous empêcher d’emmener votre enfant malade à l’hôpital 
L’épidémie de COVID-19 a eu une incidence importante sur la façon dont l’information sur la santé est communiquée, sur la façon dont les gens recherchent des renseignements et des services en santé, et sur la façon dont ces services sont fournis. Le nombre d’enfants et de familles qui se sont fait soigner dans les services des urgences des hôpitaux a considérablement diminué. Les Dres Shannon Scott et Lisa Hartling de l’Université de l’Alberta développent et évaluent des ressources pour aider les familles à comprendre l’information essentielle sur la santé et à savoir quand utiliser les services de soins de santé durant la pandémie. Elles ont montré qu’en mobilisant des parents en tant que partenaires de la santé, nous pouvons les aider à prendre des décisions, à définir les attentes en matière de traitement pour leurs enfants et à promouvoir l’utilisation efficace des services de santé. La vidéo des Dres Scott et Hartling intitulée « What to expect when visiting the ED during the COVID-19 Pandemic » (en anglais seulement) a reçu une mention spéciale lors du concours de vidéos Entretiens de l’IDSEA 2021. Visitez la chaîne YouTube d’Entretiens de l’IDSEA pour visionner toutes les vidéos présentées dans le cadre du concours de 2021 et plus encore. Apprenez-en davantage sur le concours annuel de vidéos Entretiens de l’IDSEA. |
Aider les jeunes Canadiens à renouer avec l’activité physiqueTout au long de la pandémie de COVID-19, les enfants canadiens étaient moins actifs et plus sédentaires 
Un développement sain est favorisé par une activité physique suffisante, un comportement peu sédentaire et un sommeil adéquat. Les médecins suggèrent aux enfants et aux jeunes de pratiquer au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse par jour, de ne pas passer plus de deux heures par jour devant un écran et d'avoir au moins 8 à 11 heures de sommeil réparateur par nuit pour optimiser leur santé physique et mentale. On s'attendait à ce que la pandémie de COVID-19 et les restrictions de la santé publique qui en découlent modifient la façon dont les enfants et les jeunes jouent et la mesure dans laquelle ils adoptent des comportements sains en matière d’activité physique. Il n'est donc pas surprenant que la Dre Sarah Moore, professeure adjointe à l'École de santé et de performance humaine de l'Université Dalhousie, et ses collègues de l’Institut de la santé des populations aient constaté que les enfants et les jeunes étaient moins actifs et plus sédentaires pendant la pandémie. La Dre Moore et ses collègues ont analysé les données tirées de deux enquêtes nationales, dont l'une portait spécifiquement sur les enfants et les jeunes handicapés canadiens. Les enquêtes ont permis de recueillir des renseignements sur les comportements liés à la santé des enfants et des jeunes, notamment l'activité physique, les jeux en plein air, les comportements sédentaires, le temps passé devant des écrans et le sommeil au cours de la pandémie de COVID-19. Les parents ont déclaré que la pandémie n'a pas seulement eu une incidence sur l'activité physique de leurs enfants, mais qu'elle a aussi eu une incidence négative sur leur santé mentale et physique. La vidéo de la Dre Moore intitulée « Canadian children and youth's movement and play during the pandemic » (en anglais seulement) a reçu une mention spéciale lors du concours de vidéos Entretiens de l’IDSEA 2021. Visitez la chaîne YouTube d’Entretiens de l’IDSEA pour visionner toutes les vidéos présentées dans le cadre du concours de 2021 et plus encore. Apprenez-en davantage sur le concours annuel de vidéos Entretiens de l’IDSEA. Lectures connexes :
|
Comprendre la compassionPrendre en considération ce qu’une personne veut plutôt que d’exprimer le sentiment supposément ressenti en étant à sa place 
Vous êtes-vous déjà demandé en quoi consiste au juste la compassion? En quoi diffère-t-elle de l’empathie, de la sympathie, de la gentillesse, de la sollicitude? Quels sont les éléments nécessaires pour éprouver de la compassion? Quels en sont les ingrédients clés? Le Laboratoire de recherche sur la compassion de l’Université de Calgary a élaboré le modèle pédiatrique de la compassion en se fondant sur les points de vue des patients en pédiatrie, des parents et des fournisseurs de soins de santé dans l’ensemble du Canada. Ce modèle comprend plusieurs composantes, dont une connue sous le nom de « chercher à comprendre », qui est souvent l’ingrédient oublié des soins de compassion. Peu importe notre désir de passer de la compréhension à la résolution, nos présomptions selon lesquelles nous comprenons déjà ou comprenons mieux ce dont une personne a réellement besoin, ou notre acceptation aveugle de l’idée fausse largement répandue selon laquelle la compassion consiste à saisir ce que nous ressentirions si nous étions à la place d’une autre personne, si nous ne comprenons pas la personne et la manière dont elle fait preuve de compassion de manière optimale, nous nous enfargeons dans les lacets de quelqu’un d’autre – nous nous foulons les chevilles et endommageons irrémédiablement ses espadrilles – ce qui entraîne de l’incompréhension et une gentillesse mal ciblée. La vidéo du Laboratoire de recherche sur la compassion intitulée « What is Compassion? The Defining Features and Power of Compassion » (en anglais seulement) a remporté le deuxième prix du concours de vidéos Entretiens de l’IDSEA 2021. Visitez la chaîne YouTube d’Entretiens de l’IDSEA pour visionner toutes les vidéos présentées dans le cadre du concours de 2021 et plus encore. Apprenez-en davantage sur le concours annuel de vidéos Entretiens de l’IDSEA. |
Quelle est l’incidence de l’allaitement maternel sur la santé et le développement de l’enfant?3 500 enfants canadiens et leurs familles aident les scientifiques à trouver des réponses 
L’étude de cohorte CHILD, dont le siège social est situé à l’Université McMaster, avec des sites de recrutement à l’Université de la Colombie-Britannique, à l’Université de l’Alberta, à l’Université du Manitoba et à l’Hospital for Sick Children, met à contribution près de 3 500 enfants canadiens et leurs familles d’un bout à l’autre du pays. En suivant la vie des bébés et de leurs parents pendant de nombreuses années, les chercheurs de l’étude de cohorte CHILD ont fait des découvertes emballantes sur la façon dont les facteurs génétiques et environnementaux influent sur l’asthme, les allergies, l’obésité et d’autres maladies chroniques chez les enfants. L’un de ces facteurs est l’allaitement maternel, qui procure de nombreux bienfaits pour les bébés. L’étude de cohorte CHILD a démontré que les bébés qui ont été allaités développent un niveau élevé de bactéries intestinales bénéfiques qui favorisent des modèles de croissance plus sains et diminuent chez eux les risques d’avoir une respiration sifflante et de souffrir d’asthme lorsqu’ils sont plus âgés. Elle a également permis de découvrir que la manière dont un bébé est allaité est également importante – ce qui signifie qu’il y a une différence entre l’alimentation directement au sein et l’alimentation au biberon avec du lait maternel tiré; cependant, même un allaitement de courte durée est bénéfique. La vidéo de l’étude de cohorte CHILD intitulée « New scientific insights into breastfeeding » (en anglais seulement) a remporté le premier prix du concours de vidéos Entretiens de l’IDSEA 2021. Visitez la chaîne YouTube d’Entretiens de l’IDSEA pour visionner toutes les vidéos présentées dans le cadre du concours de 2021 et plus encore. Apprenez-en davantage sur le concours annuel de vidéos Entretiens de l’IDSEA. |
Respirer naturellementUne chercheuse veut améliorer le sommeil chez les patients sous ventilation mécanique aux soins intensifs 
Quand un patient est assez malade pour être admis aux soins intensifs, il se peut qu’il ait besoin de ventilation mécanique pour respirer. Or, si cette technologie facilite l’oxygénation, elle peut aussi causer un grand inconfort et entraîner des lésions graves aux poumons. Dans un cas idéal, le respirateur travaille de concert avec le système respiratoire du patient pour produire des cycles fluides d’inspiration et d’expiration. L’asynchronie, soit un déséquilibre entre la demande respiratoire du patient et le travail du respirateur, peut entraîner une respiration anormale et nuire au sommeil du patient. Grâce à une bourse de recherche des IRSC, la Dre Telias étudie un type d’asynchronie appelé reverse triggering (déclenchement inversé), dans lequel une inspiration mécanique déclenche une deuxième inspiration, naturelle cette fois. Le patient prend donc une double inspiration, ce qui peut augmenter dangereusement le volume et la pression de l’air dans les poumons. La Dre Telias a donc conçu un algorithme qui détecte les rythmes respiratoires normaux et anormaux chez les patients. Elle recueille aussi des données de patients sur leur état de sommeil (de l’éveil complet au sommeil profond) à l’aide d’un système automatisé de notation de la profondeur du sommeil appelé Odds Ratio Product, qui lui permet aussi d’examiner la relation entre l’asynchronie, l’état de sommeil et la sédation. |
La nuit porte conseilComprendre comment le repos nocturne nous permet d’acquérir des compétences cognitives 
Tous les humains ont besoin de dormir chaque jour pour être en bonne santé physique et mentale. Le sommeil aide en effet à consolider les nouveaux souvenirs et apprentissages. Cependant, les chercheurs ne comprennent pas entièrement les processus cérébraux qui sous-tendent cette fonction du sommeil. Grâce aux fonds d’une bourse de recherche des IRSC, le Dr Dylan Smith de l’Institut de recherche en santé mentale de l’Université d’Ottawa combine électroencéphalographie et imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pour examiner le cerveau de volontaires en bonne santé et étudier ces processus en temps réel. Les participants sont placés dans un appareil d’imagerie cérébrale par résonance magnétique où ils doivent résoudre un casse-tête visuel avant de s’endormir. Le Dr Smith analyse les données des images générées en portant attention aux fuseaux du sommeil ― des éclats rapides d’activité cérébrale liés au sommeil et à la mémoire ― dans les parties du cerveau associées à l’apprentissage, comme le cortex préfrontal, l’hippocampe et le néostriatum. Ces travaux permettent de mieux comprendre comment notre cerveau intègre les nouveaux apprentissages pendant le sommeil. |
Continue de respirerCibler les neurones pour prévenir les effets mortels des opioïdes sur la respiration 
Les opioïdes peuvent soulager la douleur et améliorer le sommeil, mais ils risquent d’entraîner une dépendance, et les surdoses d’opioïdes ont causé la mort de milliers de Canadiens ces dernières années. Ces médicaments soulagent la douleur en se fixant à des récepteurs précis des cellules du cerveau qui régulent la respiration. Durant une surdose, la respiration ralentit et devient moins profonde, ce qui peut mener à l’insuffisance respiratoire et au décès. Il n’existe actuellement aucun moyen de prévenir cette dépression respiratoire causée par les opioïdes sans nuire au soulagement de la douleur qu’ils procurent. Grâce à une bourse de recherche des IRSC, le Dr Jean-Philippe Rousseau d’Unity Health Toronto étudie les neurones situés dans la partie du cerveau appelée le complexe pré-Bötzinger. Ces cellules nerveuses produisent des récepteurs opioïdes, ainsi qu’une petite molécule protéique appelée tachykinine, précurseur 1 et le récepteur neurokinine-1, qui induiraient ensemble la dépression respiratoire causée par les opioïdes. Jusqu’ici, le Dr Rousseau a découvert que la stimulation de ces cellules avec un laser bleu augmente le rythme respiratoire et soulage la dépression respiratoire chez les souris à qui on a injecté des opioïdes. |
C’est l’heure du dodo (électronique)Améliorer un programme en ligne pour les bébés et les parents 
Environ 25 % des familles rencontrent des problèmes de sommeil durant la première année de vie de leur bébé, ce qui peut avoir des répercussions sur le développement et le comportement de l’enfant, et sur la santé des parents. Grâce à une bourse de recherche des IRSC, la Dre Elizabeth Keys du campus Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique a pu travailler avec une équipe interdisciplinaire de l’Université Dalhousie pour concevoir et tester une application mobile qui donne aux parents de bébés âgés de 6 à 12 mois de l’information factuelle, des stratégies et des ressources pour favoriser le sommeil. L’application a été adaptée d’ABCs of Sleeping, une application pour les enfants d’âge scolaire que la Dre Keys a aidé à créer durant son stage postdoctoral. Dans le cadre de son travail, la Dre Keys a analysé des études sur des programmes en ligne et de cybersanté conçus pour les parents afin d’en déterminer les forces et les faiblesses. De plus, par sa participation au programme de recherche Bonnes nuits, Jours meilleurs, elle a aidé à recueillir des données sur l’influence de la COVID-19 sur les habitudes de sommeil des enfants de 85 familles canadiennes. Cette recherche a mené à la modification de ce programme en ligne, et sa mise en œuvre a été évaluée auprès de 1 000 familles du pays durant la pandémie de COVID-19. |
Usage d’opioïdes et ostéoporoseL’utilisation prolongée de ces médicaments peut fragiliser l’ossature 
Le mésusage des opioïdes a mené à une grave crise de santé publique. Durant les trois premiers mois de 2020 seulement, 1 018 décès associés à la consommation d’opioïdes ont été recensés au Canada. L’utilisation prolongée de ces médicaments peut entraîner des pertes osseuses similaires à ce qu’on observe dans les cas d’ostéoporose et accroît le risque de fractures. Il est impératif que la recherche se penche sur les répercussions de l’usage d’opioïdes sur le métabolisme, la qualité et la fragilité des os. Afin d’atteindre cet objectif de recherche, la Dre Andronowski et son équipe utilisent l’imagerie 3D haute résolution pour évaluer les effets de la consommation d’opioïdes sur la structure interne des os et leur organisation cellulaire. Ces travaux pourraient mener à la mise au point de traitements contre les pertes osseuses causées par les opioïdes. Pour y arriver, la Dre Andronowski effectue des expériences au Centre canadien de rayonnement synchrotron. |
Adapter le travail pour tout un chacunDonnées probantes appuyant la rédaction de politiques publiques qui améliorent le marché du travail pour les Canadiens et Canadiennes vivant avec un handicap 
Selon la dernière Enquête canadienne sur l’incapacité, plus d’un Canadien sur cinq vivrait avec au moins un type de handicap qui touche sa vie quotidienne. En outre, près de 650 000 Canadiens vivant avec un handicap sont sans emploi malgré leur potentiel et leur désir de travailler. Comment pouvons-nous mieux faire correspondre les objectifs de carrière des chercheurs d’emploi en situation de handicap aux besoins des employeurs? Le Dr Charles Bellemare est professeur et chercheur en économie du comportement à l’Université Laval. En tant que chercheur principal de la Disability, Employment, and Public Policies Initiative, financée conjointement par les IRSC et le CRSH, il étudie comment améliorer le marché du travail pour permettre aux personnes vivant avec un handicap de se trouver un emploi satisfaisant, d’avoir une carrière gratifiante et d’atteindre la sécurité financière. Les travaux du Dr Bellemare et de son équipe produisent de nouvelles connaissances sur les façons dont le marché du travail et les politiques publiques peuvent favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap dans l’économie canadienne. Afin d’orienter leurs recherches, le Dr Bellemare et ses collègues sont constamment en dialogue avec des personnes vivant avec un handicap afin de connaître les obstacles auxquels ces personnes se heurtent réellement dans leur recherche d’emploi et dans d’autres domaines de leur vie. Au bout du compte, ils font plus qu’aider à créer de meilleures politiques publiques : ils contribuent à apporter des changements qui permettront aux Canadiens et Canadiennes ayant un handicap de s’épanouir. |
À l'intersection de la recherche et de la sécurité communautaireDévelopper des traversées de rue sécuritaires et des espaces publics accessibles 
Un accès sûr, équitable et tout au long de l'année aux espaces et aux infrastructures communautaires est un luxe dont ne disposent pas tous les Canadiens. Les conditions météorologiques au Canada peuvent créer des obstacles et des dangers pour les personnes qui veulent accéder aux installations extérieures. Les mois d'hiver sont les plus difficiles, car la neige et le verglas peuvent rendre les trottoirs et les intersections de rues dangereux pour les piétons. C'est encore plus difficile pour les personnes handicapées. Alison Novak cherche à comprendre le rôle des infrastructures piétonnes, telles que les trottoirs, les croisements de rues et le mobilier urbain, dans le développement de quartiers vivables et propices à la marche. Ses recherches produisent des données probantes pour étayer les recommandations visant à rendre les maisons et les espaces publics plus sûrs et plus accessibles. Elle fournit notamment des données très utiles sur les dispositifs de sécurité des passages à niveau et sur la manière dont ils peuvent être conçus pour résister aux conditions hivernales et rester accessibles aux personnes handicapées. Les recherches menées par le Dr Novak contribuent à créer un environnement bâti plus sûr et à promouvoir une norme plus élevée pour les communautés accessibles. |
- Date de modification :
